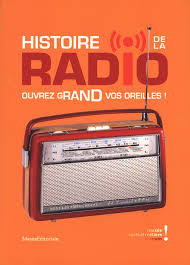DIXIÉME PARTIE
la télégraphie aérienne sous l’empire.
- mort de claude Chappe.
- la télégraphie sous la restauration.
Napoléon Ier laissa la télégraphie fort à l’écart jusqu’à la fin de son règne. Il ne s’en souvint que lorsque l’Europe coalisée se préparait à envahir la France, et menaçait ses frontières, pour la couvrir bientôt de ses bataillons. Alors seulement Napoléon fit appel à l’invention qu’il avait tant négligée. Mais il était trop tard. Auxiliaire puissant dans les guerres du dehors, pour instruire rapidement le pouvoir central, des opérations militaires qui se passent aux frontières, la télégraphie est impuissante dans un pays en partie occupé, ou seulement inquiété, par des troupes ennemies. La télégraphie aérienne avait protégé la France en 1793, et contribué à son salut, parce que notre pays était resté vierge de toute invasion victorieuse. Elle ne put la sauver en 1814, après l’entrée des alliés, qui eurent bientôt fait de détruire une ligne télégraphique précipitamment établie par l’Empereur, comme un accessoire tardif de ses opérations défensives. C’est ce que nous allons brièvement raconter.
Sous Napoléon Ier, la ligne de Paris à Lyon fut terminée, et prolongée jusqu’à Turin ; elle fut mise en activité en 1805.
Pendant la même année, la ligne du Nord, qui avait déjà un embranchement sur Boulogne, fut prolongée sur Anvers et Flessingue, et en 1810, jusqu’à Amsterdam. La ligne d’Italie fut poussée jusqu’à Milan et Venise, avec un embranchement sur Mantoue.
Claude Chappe ne devait pas voir ces derniers développements de sa chère invention. Il était déjà fort attristé du peu d’encouragement que son administration recevait de l’empereur. À cet ennui vinrent se joindre les douleurs cruelles que lui faisait éprouver une maladie chronique de la vessie. Il ne put se défendre du désespoir, et se coupa la gorge, le 25 janvier 1805.
Sa mort passa, d’ailleurs, inaperçue. On mit à sa place, comme administrateurs des lignes télégraphiques, ses deux frères Ignace et Pierre, et tout fut dit.
Mais si les gouvernements sont ingrats, la conscience publique reste fidèle au souvenir des gloires nationales. Quand on entre au cimetière du Père Lachaise, on aperçoit, dans un coin retiré, un monument très-simple, composé d’une sorte de rocher agreste, que surmonte un télégraphe de fonte. C’est la tombe de Claude Chappe. Les hommes n’ont pas élevé d’autre monument à sa mémoire ; mais il suffira, dans sa simplicité éloquente, pour rappeler le nom du savant laborieux et modeste dont la vie n’a pas été sans influence sur les destinées contemporaines.
Ignace et Pierre Chappe succédèrent donc à leur frère Claude, comme administrateurs des lignes télégraphiques, avec communauté de pouvoir et d’attributions. Leur autre frère, Abraham Chappe, était attaché à l’état-major de l’empereur.
En 1804, pendant l’organisation du camp de Boulogne, Abraham Chappe avait été chargé d’une opération difficile : il s’agissait d’établir, non un télégraphe, mais des signaux de feu, qui fussent visibles d’un bord à l’autre de la Manche. Abraham Chappe eut l’idée, pour produire une lumière capable de percer l’épaisseur des brouillards, de faire usage du gaz tonnant, avec interposition d’un globule de chaux au sein de la flamme.
Les expériences donnèrent d’excellents résultats sous le rapport de la visibilité des feux. Le volume et l’intensité de la lumière étaient énormes. Au milieu de l’obscurité de la nuit, les feux hydrogénés brûlaient comme une étoile détachée des cieux. Mais le maniement de ce mélange détonant aurait exposé à des dangers terribles. On n’avait pas encore inventé le chalumeau de Clarke, qui, maintenant les deux gaz dans des réservoirs séparés, et ne les réunissant qu’au moment de la combustion, atténue beaucoup les dangers de cet appareil. D’ailleurs, la descente en Angleterre n’ayant pas eu lieu, il ne fut point donné suite à ces expériences.
Sous l’Empire, l’administration des lignes télégraphiques était réduite à un faible personnel. Il n’y avait, dans chaque division, qu’un directeur, aux appointements de 4 000 francs, un inspecteur, avec un traitement de 2 000 francs, et un petit nombre de stationnaires payés 1 franc ou 1 franc 25 centimes par jour. À Paris se trouvaient les deux administrateurs, Ignace et René Chappe, aux appointements de 8 000 francs, secondés par une dizaine d’employés seulement. Les frais d’entretien et d’administration, qui varièrent de 150 000 à 300 000 francs, n’étaient pas entièrement fournis par l’État : la loterie en payait sa bonne part ; elle versait, comme nous l’avons dit, 100 000 francs par an dans les caisses de la télégraphie.
La télégraphie ne servait guère, en effet, sous l’Empire, pendant la paix, ou quand la guerre était portée dans les pays très-éloignés, qu’à expédier aux préfets de chaque chef-lieu, les ordres du ministre de l’intérieur, et à transmettre, chaque semaine, les numéros gagnants de la loterie. L’empereur s’en préoccupait très-peu pour l’usage de ses opérations militaires ; et s’il avait conservé Abraham Chappe dans son état-major, ce n’était qu’en prévision de quelque cas extraordinaire.
Ce cas extraordinaire se présenta, hélas ! Après la retraite de Russie, l’ennemi nous menaçait de toutes parts. Comme en 1793, nos armées devaient suppléer au nombre par la rapidité des marches et l’habileté de la stratégie. Le moment était donc arrivé d’invoquer le secours de la télégraphie. Au mois de mars 1813, l’empereur ordonna de prolonger, d’urgence, la ligne de l’Est jusqu’à Mayence, par un embranchement partant de Metz.
Napoléon déploya, pour pousser l’exécution de cette ligne, toute l’impatiente ardeur qu’il mettait à l’exécution d’un projet une fois bien arrêté dans son esprit. Il ne cessait de presser le ministre de l’intérieur, se plaignant toujours que rien ne marchât assez vite, et montrant le plus grand mécontentement à chaque retard. On mettait tout en œuvre pour lui obéir ; mais on rencontrait précisément les mêmes obstacles contre lesquels la télégraphie avait eu à lutter sous la République. Pour avoir négligé trop longtemps les progrès de la télégraphie, Napoléon trouvait devant lui les mêmes difficultés dont on avait eu à triompher aux premiers temps de cette invention. Ce n’étaient pas cette fois les ouvriers qui manquaient, mais les entrepreneurs. Les fournisseurs, qui manquaient de confiance, voulaient être payés comptant, et les mandats n’étaient soldés qu’avec des retards.
Heureusement toute l’administration des télégraphes comprenait l’importance décisive de cette ligne, et chacun payait de sa personne :
« On vit alors, dit M. Gerspach, dans son excellente Histoire administrative de la télégraphie aérienne en France, que nous avons eu tant d’occasions de citer, des directeurs et des inspecteurs, animés d’une ardeur patriotique, avancer de l’argent sur leur propre bourse, et travailler aux constructions comme de simples manœuvres… L’administration déployait une activité inconnue jusqu’alors dans ses travaux : tous étaient à l’œuvre, et les machines, fabriquées à Paris, étaient expédiées en poste à leur destination. »
La prompte exécution de cette ligne, longue de 225 kilomètres, fut, en effet, un prodige. On la construisit en deux mois et quelques jours, et elle coûta 105 000 francs. Le 29 mai 1813, les premiers signaux étaient échangés entre Mayence, Metz et Paris.
Son existence, toutefois, fut de courte durée. Bientôt, nos armées refoulées à l’intérieur, battaient en retraite ; et l’ennemi qui s’avançait, détruisait sur son passage, les machines télégraphiques. Les stationnaires défendirent leur poste jusqu’à la dernière extrémité. Toujours à l’arrière-garde, et le fusil à la main, ils faisaient tête à l’ennemi, et plusieurs payèrent cet héroïsme de leur vie ou de leur liberté.

Nous n’avons pas besoin de dire que la destruction de cette ligne, qui précéda de fort peu la chute de l’Empire, porta un coup funeste à la télégraphie française. Le nombre des stations fut considérablement réduit, et les traitements des fonctionnaires furent diminués en proportion.
Pendant les Cent Jours, Carnot avait été appelé au ministère de l’intérieur. Celui qui avait présidé à l’organisation de la télégraphie en France, ne pouvait que lui porter le plus vif intérêt. Dans son court passage au ministère, Carnot prit quelques dispositions, destinées à sauvegarder les établissements télégraphiques, et à couvrir les postes d’une protection efficace.
Carnot se disposait à faire établir un réseau maritime, destiné à relier entre eux les ports de Brest, Cherbourg et Toulon ; mais ce projet s’évanouit avec la rentrée des Bourbons à Paris, en 1815, qui vint clore définitivement la période impériale.
Le gouvernement de la Restauration porta infiniment plus d’intérêt à la télégraphie que ne lui en avait accordé Napoléon. La direction des lignes fut modifiée, d’après les nouvelles frontières assignées à la France par les souverains alliés. Strasbourg et Lyon devinrent les têtes des lignes de l’Est et du Sud-Est.
En janvier 1816, une nouvelle ligne fut établie de Paris à Calais ; car ce dernier port avait acquis une grande importance depuis le rétablissement de nos rapports avec l’Angleterre.
L’idée de mettre Paris en communication avec tous nos ports militaires, fut reprise à cette époque. On proposa de commencer par la ligne de Bordeaux. Mais en raison de difficultés diverses, on se décida à exécuter d’abord la ligne de Lyon à Toulon.
Cette ligne commença de fonctionner le 14 décembre 1821.
L’année suivante, ce fut le tour de la ligne de Bordeaux, qui passait par Orléans, Poitiers et Angoulême. Elle fut terminée en avril 1823.
En 1828 une nouvelle ligne fut établie d’Avignon à Perpignan, par Nîmes et Montpellier.
Sous la Restauration furent proposés un certain nombre de nouveaux systèmes télégraphiques, dont nous dirons un mot pour compléter cette notice. Ces projets furent d’ailleurs si nombreux que nous ne pourrons citer que ceux que le gouvernement fit examiner.
De ce nombre fut le télégraphe du contre-amiral de Saint-Haouen.
C’était un télégraphe de jour et de nuit, que l’auteur présentait comme supérieur à celui de Chappe, tant pour la rapidité de la transmission des dépêches, que pour l’économie de l’établissement et de l’entretien de l’appareil. Ce système avait déjà été repoussé sous l’Empire, après examen. L’inventeur le présenta de nouveau au gouvernement en 1820, et grâce à la protection de Louis XVIII, il obtint de le faire essayer publiquement. Une petite ligne fut établie, à titre d’essai, de Paris au mont Valérien. Sur le rapport favorable d’une commission, composée d’officiers de marine et d’ingénieurs, le conseil des ministres décida que le système du contre-amiral Saint-Haouen serait essayé en grand, sur une ligne construite à cet effet, de Paris à Orléans.
Cette expérience, qui coûta 80 000 francs à l’État, donna un démenti complet aux espérances de l’inventeur. La transmission des signaux était beaucoup plus difficile et plus lente que ceux du système Chappe.
Le télégraphe de jour et de nuit du contre-amiral de Saint-Haouen était composé d’un mât qui s’élevait à 30 pieds au-dessus de la maisonnette destinée au logement des stationnaires. Au haut de ce mât était une vergue de 18 pieds de long, placée en croix avec le mât, et à laquelle on avait suspendu trois globes d’osier peints en noir, de 2 mètres de diamètre, et éloignés de 6 pieds l’un de l’autre. Ces globes étaient hissés le long du mât, au moyen de cordes, qui descendaient dans l’intérieur de la maisonnette. Un quatrième globe, placé à 2 pieds au-dessus de la maisonnette, pouvait se déplacer horizontalement, et indiquait les mille ; tandis que les trois premiers globes placés sur trois lignes verticales, représentaient les unités, les dizaines et les centaines. Mais il était difficile de distinguer à distance, les places de ces globes, ce qui ne faisait que très-imparfaitement reconnaître les nombres désignés.
- de Saint-Haouen voulut alors, au lieu de chiffres, former des signaux, comme dans le système Chappe, en plaçant ses boules d’osier dans des positions diverses. Mais ces figures avaient trop de ressemblance entre elles, pour être facilement reconnues à une grande distance.
Le télégraphe de nuit du même inventeur consistait à remplacer les globes par des lanternes.
Tel est le système qui fut établi sur 12 stations, de Paris à Orléans. L’expérience solennelle en fut faite le 17 août 1822, à 10 heures du soir, en présence des commissaires choisis par le gouvernement. Ces commissaires, qui s’étaient placés à la première station, sur la butte Montmartre, adressèrent à Orléans une question très-courte. Ils attendirent vainement la réponse pendant deux heures, et se retirèrent, pour adresser au gouvernement un rapport, qui fit rejeter sans retour cet insuffisant système.
Le vigigraphe est une autre invention télégraphique, qui a occupé assez longtemps l’attention publique. Cet instrument que l’on voit représenté ici (fig. 17), d’après le dessin qu’en a donné Ignace Chappe dans son Histoire de la télégraphie, se composait d’une échelle AB, placée verticalement, portant deux traverses fixes CD, et une troisième traverse mobile EF, qui pouvait monter et descendre le long de l’échelle. Un disque G, placé de l’autre côté de l’échelle, pouvait également monter et descendre dans toute la longueur de la même échelle.

Les différentes positions du disque mobile et de la traverse brisée, c’est-à-dire le voyant rond, et le voyant brisé, servaient à indiquer les chiffres. Le voyant rond G, placé au-dessus de la traverse CD, indiquait le zéro ; le voyant brisé EF, porté à la même place, exprimait l’unité. L’isolement égal des deux voyants marquait 2 et 3. Placés au-dessous de la traverse supérieure, ils indiquaient les chiffres 4 et 5 ; au-dessus de cette traverse, 6 et 7 ; au plus haut de l’espace, 8 et 9. Le voyant rond marquait les nombres pairs, et le voyant brisé les nombres impairs.
Tout cet appareil resta longtemps dressé sur la tour de l’église Saint-Roch, à Paris ; mais il ne fut soumis à aucune expérience. Le vigigraphe était surtout destiné à être placé sur les côtes, pour servir de signaux maritimes. L’appareil transporté à Rochefort, donna de bons résultats. C’est le même système qui, aujourd’hui, simplifié et modifié, constitue les sémaphores, placés à l’entrée de tous nos ports.
C’était aussi une espèce de vigigraphe qui avait été établi dans une série de postes allant de Paris à Rouen. Le gouvernement avait autorisé la création de cette véritable télégraphie privée, qui servit longtemps à transmettre à Rouen le cours de la Bourse de Paris. Le cours de la Bourse de Paris était affiché tous les jours à celle de Rouen. Cette télégraphie privée fonctionna jusqu’à la loi qui fut portée en 1837, pour interdire aux particuliers toute correspondance télégraphique.
On ne peut parler que pour mémoire, du télégraphe aérien de Bréguet et Bettancourt, dont l’expérience prouva toute l’insuffisance, et dont l’invention, du reste, était bien antérieure à l’époque dont nous parlons.
Bréguet et Bettancourt, dans les premières années de notre siècle, présentèrent au gouvernement et soumirent à différentes expériences, leur système télégraphique, qui différait de celui de Chappe et avait un certain côté d’originalité. Une verge métallique ressemblant au régulateur du télégraphe Chappe, pouvait tourner, de manière à occuper toutes les positions, à l’extrémité d’une longue perche, plantée verticalement. Les divers angles formés par l’aiguille mobile et la perche, servaient de signaux. Un cadran placé à l’extrémité inférieure de la perche, marquait l’angle décrit par la flèche. Quand on voulait faire un signal, on n’avait qu’à placer l’index du cadran sur la division correspondante à cet angle, en tirant la corde au moyen de manivelles qui étaient placées sur la circonférence d’une large poulie.

Ce système était évidemment d’une grande simplicité. Malheureusement, il était difficile d’évaluer exactement de loin, au moyen de la lunette d’approche, les angles ainsi formés ; Bréguet et Bettancourt, mécaniciens habiles, avaient imaginé des dispositions très-ingénieuses pour apprécier exactement cet angle. Une expérience faite à 1 kilomètre de distance, avec un de leurs appareils, par des commissaires nommés par le gouvernement, donna de bons résultats. Mais l’application d’un instrument de précision, tel que le micromètre à la télégraphie, ne pouvait être sérieusement tentée. Malgré l’approbation que reçut cet appareil de plusieurs sociétés savantes, il ne put jamais se faire adopter par le gouvernement.
Nous passerons sous silence d’autres systèmes télégraphiques, tels que celui de Villalongue, qu’approuvait Arago, et celui de Gonon, qui fut essayé sur la butte Montmartre. Tous ces appareils étaient de beaucoup inférieurs à celui de Chappe.
Un perfectionnement avantageux fut néanmoins apporté au système de Chappe. Déjà sous l’Empire, l’inspecteur Durand avait proposé de rendre le régulateur immobile, et de placer au-dessous un régulateur plus petit et mobile, c’est-à-dire pouvant tourner autour d’un centre. Les frères Chappe avaient repoussé cette innovation, désireux de conserver à leur machine sa forme primitive. Cette idée fut reprise et transportée dans la pratique, par l’administrateur que la révolution de 1848 avait mis à la tête du service télégraphique, M. Ferdinand Flocon.
Ce système, que l’on a appelé à tort le système Flocon, avait l’avantage d’offrir moins de prise au vent, de faciliter le jeu des manivelles, et de rendre d’un tiers plus rapide le passage des signaux. Il fut établi sur la ligne de Calais à Boulogne, et sur une partie de la ligne du Midi. Il se serait probablement généralisé partout, si, à cette époque, les jours de la télégraphie aérienne n’avaient été déjà comptés.
Nous voici arrivés à l’année 1830, époque critique pour la télégraphie.
Le gouvernement provisoire de juillet 1830, afin de diriger et de surveiller le mouvement politique, en ce moment de crise, s’était empressé de mettre la main sur les télégraphes. Sur la demande de Bérard, membre du gouvernement provisoire, un député nommé Marchal, fut nommé commissaire du gouvernement près les télégraphes.
Le commissaire du gouvernement de juillet intima au directeur l’ordre de lui livrer le vocabulaire.
Les frères Chappe régnaient en maîtres, depuis vingt ans, dans cette administration, qu’ils regardaient, avec raison, comme leur patrimoine, comme un privilége attaché à leur nom, comme une récompense des services rendus par leur famille. Cette autorité despotique et sans contrôle, qu’ils exerçaient sur toute l’administration, et qui mettait à leur merci la situation des fonctionnaires et des agents, à tous les degrés de l’échelle des emplois, était peut-être nécessaire pour un service dont la régularité eût été compromise par la désobéissance ou l’infidélité d’un seul agent. Les Chappe avaient donc seuls l’intelligence du vocabulaire, et ils n’en rendaient compte qu’au roi. Ils ne relevaient que d’eux-mêmes, pour les nominations des employés. Toutes ces habitudes, peu conformes sans doute aux principes de l’administration actuelle, étaient dans l’esprit du temps, comme dans celui d’une institution, qui avait pour base le secret le plus rigoureux. Mais le gouvernement de 1830 ne s’accommoda pas d’un tel système. Il voulut briser les résistances des administrateurs qui régnaient en souverains irresponsables dans le domaine de la télégraphie.
Comme il fallait que quelqu’un cédât, les frères Chappe donnèrent leur démission.
Par une ordonnance royale du mois d’octobre 1830, M. Marchal fut nommé administrateur provisoire des télégraphes. La même ordonnance mettait à la retraite Réné Chappe.
Réné Chappe avait été mis à la retraite pour ses démêlés avec le gouvernement provisoire. Ignace fut également mis à la retraite, tout simplement parce qu’on avait besoin de sa place. Il avait pourtant prêté serment au gouvernement provisoire, « comme j’en avais prêté dix autres ! » ajoute-t-il, dans une brochure publiée au Mans, où il s’était retiré.
Hâtons-nous de dire que le gouvernement de juillet se montra assez mal inspiré dans cette affaire. Le nom des inventeurs de la télégraphie est une des gloires de la France ; leur découverte avait excité l’envie et l’admiration de l’Europe ; leur fortune s’était épuisée dans de longues et dispendieuses études ; ils avaient donné à l’administration quarante années de leur vie : ils avaient donc bien acquis le droit de mourir à leur poste.
L’année 1830 marque un temps d’arrêt dans l’histoire de la télégraphie aérienne. Nous en profiterons pour donner la description détaillée, que nous n’avons pu présenter encore, de l’appareil télégraphique de Chappe. Nous jetterons ensuite un coup d’œil rapide sur l’adoption qui fut faite en divers pays de l’Europe, de ce même système télégraphique, pendant l’époque que nous venons de considérer
(extrait de Wiki source)