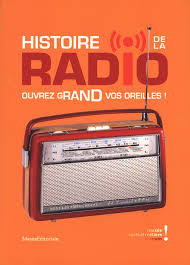QUINZIÈME PARTIE
- La télégraphie navale.
- le code marryatt.
- le code reynold.
- le code larkins, ou code commercial des signaux anglo-français.
Cette langue universelle dont il vient d’être question, a été réalisée de nos jours, dans un cas dont tout le monde comprend l’importance : pour les communications entre les navires de toutes les nations.
La transmission des ordres d’un bâtiment à l’autre, quand ces bâtiments appartiennent à la même nation, présente peu de difficulté, comme aussi peu d’intérêt. La tactique navale, réglementaire à bord des bâtiments, a résolu ce problème d’une manière satisfaisante. Des pavillons de différentes couleurs et de diverses formes, servent à établir les communications, soit d’un bâtiment à l’autre, soit d’un bâtiment à un canot, etc. Nous n’avons rien à dire de cette partie de la tactique navale. Ici, en effet, il n’est point question d’une langue universelle, mais seulement d’un échange de signaux entre des marins d’une même nation.
Mais où la langue universelle trouve son application, c’est dans l’échange des signaux qu’il faut faire entre des bâtiments qui se rencontrent en mer, et qui appartiennent à une nation quelconque. Il faut que ces deux bâtiments qui s’aperçoivent au large, puissent s’entretenir et se parler, quelle que soit leur nationalité respective. Il faut qu’un idiôme nautique universel, une langue conventionnelle, comparable à l’écriture symbolique des Chinois, aux hiéroglyphes égyptiens, ou bien au langage mimique des sourds-muets, permette aux marins de se faire comprendre les uns des autres, sans qu’ils aient besoin de parler trente langues, comme le célèbre polyglotte de notre siècle, le cardinal Mezzofanti, mort à Naples, en 1849.
Cette langue nautique universelle existe, cette conception admirable d’un langage maritime qui ne se parle pas, mais qui se lit, a été réalisée. Il existe aujourd’hui des Codes spéciaux répondant à des signaux que tous les marins peuvent exécuter et comprendre. Il suffit que chaque navire soit muni d’une édition du Code commercial de signaux dans sa langue nationale, pour qu’il soit à même de se servir de l’idiôme universel, comme de sa propre langue, et de s’entretenir avec tous les navires qu’il rencontre.
Ce n’est pas sans difficulté, ce n’est qu’avec le concours permanent d’un grand nombre d’hommes voués à cette étude chez les différentes nations, que l’on est parvenu à créer la langue maritime universelle qui permet d’établir par des signaux, une communication entre deux navires étrangers. Il ne sera pas sans intérêt de passer en revue les différents systèmes, qui ont été essayés en Angleterre et en France, pour arriver à ce grand résultat, atteint aujourd’hui d’une manière à peu près complète.
L’utilité d’un système universel de signaux maritimes est de toute évidence. Combien de catastrophes auraient été évitées, combien de périls détournés, combien d’argent économisé, s’il eût été toujours possible aux navires qui se croisent, d’échanger des avis, de s’instruire mutuellement de ce qui se passait dans les différents ports qu’ils avaient visités. L’importance de ce genre de communication, aux points de vue commercial, politique et militaire, n’a pas besoin d’être plus longuement établie ; elle saute aux yeux.
Mais en dehors de cette utilité commerciale ou nautique, on comprend que la simple possibilité d’échanger, de temps à autre, quelques phrases, ne soit pas un médiocre service rendu aux gens de mer. Sur un navire, tout devient distraction. Un lambeau de conversation, lancé à travers l’espace, est une véritable jouissance pour celui qui, pendant des semaines entières, n’a vu que le ciel et l’eau. Dès qu’un navire apparaît à l’horizon, il est l’objet de la curiosité de l’équipage. On fait des conjectures sur sa nationalité et sa destination. On cherche à distinguer la forme de sa coque et son pavillon. Quand on s’est approché à une distance convenable, on se fait des signes, et l’on cherche à entamer une conversation. Le capitaine fait arborer ses pavillons hiéroglyphiques ; il dresse les signaux de la langue nautique, puis il attend la réponse. Mais trop souvent, ces signaux sont lettre morte : on parle dans le désert. L’étranger ne comprend pas, car il a un autre code à son bord, de sorte qu’avec la meilleure volonté du monde, on ne peut parvenir à échanger deux phrases qui offrent un sens quelconque. On se sépare donc avec dépit, sans avoir pu se dire un mot.
Les différents codes qui ont été jusqu’ici en usage dans la marine des différentes nations, n’étaient pas sans valeur pratique ; mais aucun n’offrait assez d’avantages pour que l’on eût pu réussir à le faire adopter d’une manière générale. On connaît les Codes de signaux maritimes de Marryatt, de Rogers, de Ward, de Reynold, de Rhode et bien d’autres encore.
Le plus répandu des Codes maritimes actuels, est celui que l’on doit au capitaine anglais Marryatt.
Le Code Marryatt est fondé sur le système décimal. Les mots, noms et phrases formant les différentes communications qu’on peut vouloir échanger, y sont désignés par des numéros. On signale ces numéros par des combinaisons de dix pavillons de couleurs différentes, affectés aux dix chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ces numéros renvoient au vocabulaire, qui prend ici le nom de code de signaux. Les combinaisons contenant plusieurs fois le même chiffre, sont exclues pour ne pas augmenter le nombre des pavillons. On arrive ainsi, en combinant jusqu’à quatre chiffres, à un total de 5 860 groupes, dont le dernier est numéroté 9876. C’est le nombre le plus élevé que l’on puisse former avec quatre chiffres différents.
Pour augmenter le total des communications possibles, on a imaginé de former six séries ou sections, dans lesquelles se répétaient les mêmes numéros d’ordre ; il faut donc, en outre, désigner chaque fois la série dans laquelle un numéro donné doit être cherché. On emploie, à cet effet, une caractéristique spéciale, que l’on hisse soit au-dessus des autres pavillons, soit à un mât séparé.
La première série comprend la liste des bâtiments de guerre anglais ; la deuxième, celle des bâtiments de guerre étrangers ; la troisième, les bâtiments de commerce ; la quatrième, les noms géographiques les plus importants (phares, relâches, mouillages, villes) ; la cinquième est le répertoire des phrases les plus usitées ; enfin, la sixième forme un vocabulaire de mots destinés à composer des phrases non mentionnées dans la série précédente.
Mais les 5 860 numéros de la troisième série, n’auraient jamais suffi pour désigner tous les bâtiments de commerce ; il a donc fallu la subdiviser encore une fois en trois parties, qui se distinguent l’une de l’autre par une flamme spéciale. Le nombre des signes de la plupart des communications est ainsi porté à cinq, au lieu de quatre, ce qui est un inconvénient des plus graves. La pratique a montré, en effet, que l’emploi de plus de quatre signes sur la même drisse, comporte de nombreuses chances d’erreurs, et si l’on se décide à hisser le cinquième pavillon sur un mât séparé, on risque encore qu’il ne soit pas aperçu.
Le principal défaut de ce système, d’ailleurs fort ingénieux, c’est le nombre insuffisant des combinaisons dont il permet de disposer. L’édition de 1854 du Code Marryatt contient environ 11 000 noms de bâtiments de commerce, rangés par ordre alphabétique ; tous les navires portant le même nom sont représentés par le même signal. On arrive ainsi à ne pas dépasser les ressources du système adopté. Mais la liste des bâtiments du commerce anglais, publiée en 1865, d’après le Registrar general of shipping and seamen, contient déjà plus de 52 000 numéros ! Comment les aurait-on fait entrer dans le Code Marryatt ? Quant à l’idée de donner le même numéro aux navires de même nom, on comprendra combien elle est malencontreuse quand on saura, par exemple, que plus de cent cinquante bâtiments anglais et américains, dont le tonnage dépasse cinquante tonneaux, portent le nom d’Élise, sans compter ceux qui s’appellent Élise-Anne, Élise-Marie, etc. Quatre de ces Élise appartiennent au port de Londres. On était bien avancé quand, après avoir échangé quelques signaux avec un navire qu’on rencontrait, on savait qu’il s’appelait Élise ! Aussi, les listes qui se publient aujourd’hui en Angleterre renferment-elles, non-seulement le nom et la nature du bâtiment, son tonnage et la forme de sa machine, mais encore le nom et l’adresse de l’armateur.
Le vocabulaire et le répertoire de phrases du Code Marryatt étaient également insuffisants et d’une disposition peu commode.
Les signaux du système Marryatt, qui s’exécutaient au moyen de pavillons de différentes couleurs, avaient enfin l’inconvénient de se confondre, quand ils étaient observés de loin, lorsque le calme empêchait les pavillons de flotter, ou quand la direction du vent les présentait à l’observateur dans le sens debout.
Tout cela pourtant ne doit pas nous empêcher de reconnaître que le Code anglais a rendu de grands services, et qu’il a servi de modèle au nouveau Code commercial anglo-français, que nous ferons connaître plus loin.
C’est à un marin français, M. Reynold de Chauvancy, capitaine de port, qu’appartient le grand honneur d’avoir le premier remplacé le système du capitaine Marryatt, par une combinaison infiniment plus commode et plus simple. M. Reynold substitua la forme des corps à la couleur des pavillons, en ne faisant usage, à l’imitation du système de François Sudre, que de trois formes, à savoir : un pavillon, une flamme et un globe, ou plutôt un objet opaque quelconque, tel qu’un ballon ou un chapeau.
Le système Marryatt était par lui-même très-dispendieux ; il exigeait l’emploi de séries de pavillons semblables à celles dont sont pourvus les bâtiments de l’État. Le système Reynold, au contraire (qui permet d’ailleurs aussi l’emploi des pavillons réglementaires), se compose d’une série de trois signes incolores, qui ne coûtent absolument rien, puisque tout navire en possède les éléments indispensables, et qui sont tout simplement : 1o un pavillon de n’importe quelle couleur ; 2o un lambeau d’étoffe figurant une flamme ; 3o et un objet opaque quelconque, tel qu’un ballon, une manne, un chapeau, etc. Un vocabulaire qui renferme plus de 18 000 mots, permet de traduire, avec ces trois signaux, toutes les idées qui peuvent être échangées dans une correspondance.

La figure 28, fait voir un navire portant à son mât les trois signaux, de forme différente, dont les combinaisons répondent à l’un des 18 000 mots du vocabulaire de M. Reynold. Les numéros de ce vocabulaire signalés au moyen de ces trois objets, servent aux navires pour correspondre à distance.
Il est impossible de ne pas être frappé des avantages qui résultent, pour la marine et le commerce maritime, de l’adoption d’une télégraphie si simple qu’elle est à portée de toutes les intelligences, si peu dispendieuse, qu’en toutes circonstances le plus humble caboteur possède à son bord les éléments nécessaires pour la représenter, et qui, traduite dans les langues les plus usitées en marine, donnera toujours, dans toutes ces langues, au moyen d’un même numéro correspondant, l’explication précise du signal. En se servant de cette télégraphie polyglotte, un marin, à l’entrée d’un port étranger, pourra toujours faire comprendre ses besoins, et comprendre ce qu’on lui demandera, sans avoir préalablement étudié la langue en usage dans ce port. Il y a loin de là à ces séries de pavillons très-dispendieuses d’achat et d’entretien, qu’exige le code Marryatt. Ici, comme nous venons de le dire, les engins nécessaires à l’exécution des signaux, ne coûtent rien.
C’est par ces considérations que le système Reynold a été adopté pendant un certain temps, par le gouvernement français. Une décision du 26 juin 1855, de M. Hamelin, ministre de la marine, rendit obligatoire pour la marine marchande française, le code Reynold, que déjà son prédécesseur, le ministre Ducos, avait rendu, pendant la même année, obligatoire pour la marine militaire. L’amiral Hamelin ordonna que le code Reynold serait obligatoire à bord de tous les navires de commerce français naviguant au long cours et au cabotage, ainsi qu’à bord des bâteaux-pilotes. Afin d’assurer l’exécution de cette disposition, une apostille, portée sur le rôle d’équipage, devait mentionner que le capitaine du navire était pourvu de ce code ; en outre, le nom du navire, ainsi que celui du port d’armement, devaient être inscrits sur l’exemplaire présenté.
Il fallait obtenir des autres nations maritimes l’adoption du code Reynold, pour les relations internationales. On obtint l’adhésion de quinze nations, l’Angleterre, la Hollande, la Sardaigne, Naples, la Grèce, la Belgique, la Prusse, la Suède, la Russie, les républiques espagnoles, Hambourg, etc.
Le code Reynold fut traduit en anglais, en italien, en allemand, en suédois, etc.
Le code Reynold était excellent et répondait à tous les besoins de la correspondance maritime ; mais il avait un défaut : il avait le défaut d’être français, ce que l’orgueil britannique ne pardonne guère dans les questions de marine. Il était français et par l’inventeur, et par le gouvernement qui s’était appliqué à en propager l’usage. L’Angleterre refusa donc de rester plus longtemps dans le concert des nations maritimes qui avaient adopté le Code français. Sur les observations de la marine anglaise, à laquelle vinrent se joindre, il faut le dire, des remarques émanant des officiers de notre marine impériale et de notre marine marchande, diverses enquêtes furent ouvertes. Le conseil d’amirauté, d’accord avec le comité hydrographique, reconnut que le monopole accordé au code Reynold n’était motivé par aucune considération d’intérêt public ou d’utilité pratique.
À la suite de ces diverses enquêtes, une décision rendue le 30 avril 1863, par le ministre de la marine, M. de Chasseloup-Laubat, abrogea les arrêtés de 1855.
Mais le besoin d’un code international commode et pratique, se fit alors sentir plus que jamais. L’habitude des communications postales et des dépêches télégraphiques a augmenté nos légitimes exigences. L’échange de quelques avis techniques ne peut plus suffire au marin ; il veut avoir une télégraphie à lui, qui lui permette d’exprimer toutes ses idées et de correspondre avec tous les navires qu’il rencontre sur sa route.
L’insuffisance des moyens de communication dont on disposait jusqu’ici, a été regrettée plus d’une fois, pendant les guerres de Crimée, d’Italie, en Chine, en Cochinchine, au Mexique, quand nos bâtiments se voyaient dans l’impossibilité de se faire comprendre par les navires italiens, anglais, espagnols, ou même par les navires marchands de notre nation. Il était donc urgent d’aviser aux moyens de faire cesser un état de choses aussi fâcheux.
Le gouvernement français, préoccupé depuis longtemps de la solution de ce problème, se décida à faire des ouvertures au cabinet de Londres. Une commission anglo-française fut bientôt chargée de préparer un système de signaux propre à être adopté par toutes les nations maritimes. Les projets de cette commission furent sanctionnés par un décret impérial en date du 25 juin 1864. Les dix-huit mois qui suivirent cette date furent employés à l’impression des éditions française et anglaise du nouveau Code commercial des signaux.
Au mois de février 1866, le ministre de la marine, M. de Chasseloup-Laubat, présentait à l’Empereur le premier exemplaire de l’édition française du Code commercial de signaux, qui a été élaboré par une commission anglo-française et publié simultanément à Paris et à Londres sous les auspices des deux gouvernements.
- Larkins, membre du Board of trade, en Angleterre, et en France M. Sallandrouze de Lamornaix, lieutenant de vaisseau, un des jeunes officiers les plus distingués de notre marine, ont dirigé ce difficile et minutieux travail, en français et en anglais. Déjà plusieurs gouvernements ont fait connaître leur désir d’adopter ce Code international, et l’on peut espérer que sous peu, toutes les nations maritimes donneront leur adhésion à cette œuvre de civilisation et de paix.
Les gouvernements anglais et français ne veulent pas imposer ce code à la marine marchande d’une manière obligatoire ; mais les avantages qui résulteront de son adoption sont trop considérables pour qu’il ne se répande pas rapidement parmi les marines de toutes les nations.
Expliquons le plan et l’usage du nouveau code international, ou Code Larkins anglo-français.
Toute langue maritime se compose nécessairement : 1o d’un ensemble d’idées ou de communications, qu’il s’agit de traduire par des signaux ; 2o d’un alphabet de mouvements ou d’apparitions propres à former ces signaux.
Le système Larkins anglo-français, consiste dans l’emploi de 78 642 combinaisons de deux, trois ou quatre consonnes, et dans l’usage d’un pavillon de forme et de couleur déterminées, pour figurer chaque consonne.
Dix-huit pavillons, représentant les dix-huit consonnes de notre alphabet, suffisent, si on les réunit par groupes de deux, de trois ou de quatre, pour obtenir ce nombre prodigieux de combinaisons différentes. Chaque combinaison est affectée à la représentation d’une idée déterminée. Elle signifie soit un mot, soit une phrase. Des vocabulaires spéciaux ou codes renferment la traduction de ces mots et de ces phrases, dans toutes les langues modernes.
Les signaux se distinguent par leur forme et par leur couleur, qui doivent être choisies parmi les plus tranchées, les plus faciles à reconnaître de loin. On n’a donc employé dans le nouveau code, que des pavillons carrés, des pavillons triangulaires (flammes) ou des pavillons carrés évidés d’un côté (guidons). Les couleurs adoptées sont : le blanc, le bleu, le jaune et le rouge. La planche imprimée des pavillons destinés à l’usage des navires marchands de toutes les nations, est formée d’un guidon rouge, de quatre flammes composées de deux couleurs, et de treize pavillons carrés, également à deux couleurs, dessinant des raies, des casiers, des croix, etc. Ces dix-huit pavillons ont été choisis parmi ceux qui étaient déjà usités dans les anciens codes ; ils seront les mêmes pour toutes les marines marchandes. Pour les marines militaires, on a composé des planches spéciales, renfermant dix-huit pavillons de même forme que ceux des navires de commerce, mais à dessins légèrement différents ; ils ont été pris parmi les signes déjà en usage à bord des navires de guerre.
Les dix-huit pavillons désignent, dans le nouveau code, les dix-huit consonnes de notre alphabet. Le guidon représente B ; les quatre flammes C, D, F, G ; les carrés H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W.
On aurait pu ajouter un signal Z, si on avait voulu augmenter considérablement le nombre des combinaisons possibles ; mais 78 642 signaux qu’on obtient en combinant de différentes manières deux, trois ou quatre des pavillons adoptés, ont paru former un total bien suffisant.
Les pavillons se groupent ensemble, les uns au-dessus des autres, le long d’une drisse (corde que l’on hisse le long d’un mât). Le bâtiment interpellé lit alors, au haut du mât, un signal composé de plusieurs lettres. Il en cherche la signification dans son code, et il répond par un autre signal, après avoir cherché dans le même dictionnaire, le symbole du mot ou de la phrase qu’il veut transmettre.
Supposons, par exemple, qu’un capitaine naviguant dans l’océan Pacifique, en rencontre un autre se rendant à Valparaiso, et qui doit avoir pris la mer sans avoir eu connaissance de la déclaration de guerre entre l’Espagne et le Chili. Il veut faire savoir à l’équipage étranger que les navires espagnols bloquent les ports chiliens, et lui conseiller de suivre une autre route. À cet effet, il hissera successivement les signaux suivants, dont le Code commercial, qui existe à bord de l’autre navire, lui donnera la traduction fidèle dans sa langue, que nous supposerons être la langue française.
| J. N. | Guerre entre |
| B. C. V. T. | Espagne. |
| B. N. S. Q. | Chili. |
| C. L. Q. P. | Vous serez arrêté par les bâtiments du blocus. |
| M. Q. B. | Vous feriez mieux de faire route pour |
| B. N. R. M. | Callao. |
| N. R. Q. | On ne peut se procurer un bon fret. |
À cet excellent avis, le navire répondra :
| N. K. B. | Très-obligé pour |
| G. M. Q. N. | Avis. |
Sur le nombre total des combinaisons inscrites dans le code, 53 environ sont affectées aux noms des bâtiments. Mais comme ce nombre serait encore loin de suffire à la désignation de tous les navires, la série entière est laissée à la disposition de chaque nation maritime, qui pourra en répartir les signaux à sa manière ; le pavillon national servira à distinguer les navires portant le même numéro. Les 25 000 autres signaux servent à composer toutes les communications possibles. Ils représentent, comme le montre l’exemple ci-dessus, des objets, des noms géographiques, des membres de phrases ou des phrases entières, des nombres ou des syllabes permettant d’épeler les noms propres. Les combinaisons de deux ou trois signes ont été réservées pour les communications les plus utiles lors des rencontres à la mer ; celles de deux signes spécialement pour les avis importants et pressés.
Le Code anglo-français est divisé en deux volumes. Le premier, comprenant le dictionnaire de la langue universelle ; le second, la liste des navires. Le dictionnaire se divise lui-même en deux parties. La première présente, rangés par ordre alphabétique, les mots les plus usuels. Autour de chaque mot sont groupés les membres de phrase et les phrases dans lesquelles ce mot joue un rôle essentiel. En regard de chaque lambeau de phrase se trouve le signal qui l’exprime. L’autre partie sert à déchiffrer les signaux ; elle renferme les différentes combinaisons de consonnes, rangées par ordre alphabétique, et suivies de leur interprétation. Les différentes nations maritimes ne tarderont pas à publier des dictionnaires analogues à l’usage de leurs bâtiments.
Les signaux dont il a été question jusqu’ici, sont parfaitement visibles à des distances peu considérables, mais ils cesseraient de l’être au delà d’un certain éloignement. Dans ce cas, on emploie une autre catégorie de signaux, empruntée au code Reynold : les combinaisons d’une boule, d’une flamme et d’un pavillon carré. Ces combinaisons, au nombre de dix-huit, remplacent les dix-huit signaux de petite distance, et représentent chacune une consonne déterminée. On compose un groupe de consonnes en arborant successivement plusieurs de ces signaux, et faisant précéder le premier et suivre le dernier, par une boule élevée seule. En outre, on a affecté à chacun des dix-huit signaux de grande distance une signification spéciale et urgente ; et dans ce cas, on le fait précéder et suivre d’une boule, pour faire savoir qu’il doit être considéré isolément. Enfin, on arrivera peut-être à employer le même dictionnaire pour les signaux de nuit, en choisissant dix-huit groupes de lanternes ou d’autres objets facilement visibles, auxquels on donnera les noms des dix-huit consonnes ; mais cette question est encore à l’étude.

Nous venons de dire que le nouveau code anglo-français, ou Code Larkins, conserve les signaux du code Reynold, quand on se trouve à une trop grande distance. La figure 29 représente l’application du code Reynold à ce cas particulier. On trouve expliqué comme il suit, dans l’ouvrage de M. de Reynold, la manière de communiquer entre des troupes de débarquement et des bâtiments en rade.
« En cas de détresse, dit M. Reynold, de manque de tout pour faire les signaux indiqués précédemment, un homme seul peut les représenter, ainsi que l’ont reconnu les commissions.
Un homme donc, élevant verticalement, soit au bout d’un fusil, soit au bout d’une gaffe, un objet flottant, tel qu’un pavillon, un mouchoir, un lambeau d’étoffe, signifiera comme le pavillon seul des signaux de jour : attention, aperçu, virgule, ou le signe {\displaystyle +}.
| Étendant
le bras |
droit, | horizontalement, avec un objet flottant, il représentera | 1 | |
| » | à 45° | 2 | ||
| gauche, | horizontalement | 3 | ||
| » | à 45° | 4 | ||
| droit, | horizontalement, avec un objet opaque (un chapeau, une manne) | 5 | ||
| » | à 45° | 6 | ||
| gauche, | horizontalement | 7 | ||
| » | à 45° | 8 | ||
| Le bras droit horizontal avec un objet flottant, le bras gauche horizontal avec un objet opaque | 9 | |||
| Le bras gauche horizontal avec un objet flottant, le bras droit horizontal avec un objet opaque | 0 | |||
| On peut représenter ainsi toutes les combinaisons de nombres. » | ||||
Nous n’avons parlé jusqu’ici que des moyens que les navires auront désormais de correspondre entre eux. Mais le Code commercial assure aussi leur communication avec les côtes, par l’intermédiaire des sémaphores. Depuis le 1er mai 1866, tous nos sémaphores sont en mesure d’entrer en correspondance avec les navires qui passent au large, au moyen des signaux de grande distance du Code commercial, composés comme à l’ordinaire, ou bien représentés par les différentes positions des ailes des sémaphores. Ces derniers vont ainsi étendre les réseaux de nos télégraphes jusque dans l’Océan. Toutes les stations de nos rivages étaient déjà transformées en véritables bureaux télégraphiques ; elles vont devenir aussi des bureaux de poste. Depuis le 15 mai 1866, les guetteurs expédient par le télégraphe électrique, ou par la poste, toutes les communications qu’ils reçoivent des bâtiments en mer. La surtaxe de transmission maritime est fixée à 2 francs pour une dépêche télégraphique ou postale de vingt groupes. Les guetteurs signaleront de même, aux navires, les ordres, avis ou dépêches des armateurs. Les dépêches maritimes pourront être formulées en groupes de deux, trois ou quatre lettres, qui représenteront, à volonté, un sens secret convenu entre l’expéditeur et le destinataire, ou une des phrases du Code commercial.
Tout le monde comprend l’importance de ces mesures. On n’aura plus besoin, à l’avenir, d’attendre l’arrivée des paquebots pour connaître les nouvelles qu’ils apportent. L’armateur, averti de la présence de son navire en vue de la côte, pourra lui envoyer l’ordre d’aller déposer son chargement dans tel port où il aura trouvé un placement avantageux de ses marchandises. Le même moyen servira à éviter des retards, à économiser des frais inutiles, quelquefois à prévenir une catastrophe commerciale.
Ce n’est pas tout encore : les sémaphores, grâce au code commercial, rempliront une autre mission, tout aussi importante que celle pour laquelle ils ont été primitivement créés. Ils serviront à faire connaître aux navires les possibilités de mauvais temps, les tempêtes qui s’approchent, enfin toutes les pressions météorologiques intéressant la navigation.
Les signaux météorologiques d’avertissement sont exécutés au moyen de cônes et de cylindres en toile. Un cône dont la pointe est tournée vers le ciel, indique un coup de vent probable, venant du nord ; si la pointe est tournée vers la terre, on doit craindre un coup de vent du sud. Ces avertissements mettront les navires à même de prendre toutes les précautions nécessaires. Enfin, un pavillon noir sert à avertir d’un sinistre la côte et le large, et à appeler du secours.
Tant de précautions rassemblées finiront certainement par diminuer le nombre des sinistres de mer.
Bientôt, sans doute, l’expérience et la pratique auront consacré les dispositions du nouveau Code commercial anglo-français, et nous le verrons adopté par toutes les nations maritimes. L’initiative de la France n’aura pas été stérile en cette circonstance. S’il est impossible de supprimer les barrières de nationalités ou de frontières qui séparent les peuples modernes, au moins l’unité de langage régnera-t-elle sur la vaste étendue des mers ; et l’on verra cette langue universelle, dont le rêve a été caressé par tant de philosophes, réalisée, sinon sur la terre, au moins sur le domaine des eaux. Ainsi, l’on verra cesser la confusion des langues qui régnait sur mer ; la tour de Babel maritime aura fini son temps.
fin du télégraphe aérien.
- ↑ Bibliothèque britannique, nos 215, 216.
- ↑ Suétone.
- ↑ Gibbon, Histoire de la décadence de l’empire romain, 14e vol., p. 410.
- ↑ Sic enim Julius Cæsar, quando voluit Angliam expugnare, refertur maxima specula erexisse, ut a Gallicano littore dispositionem civitatum et castrorum Angliæ prævideret. Similiter, possent specula erigi in alto, contra civitates et exercitus. (Opus majus.)
- ↑ Histoire de la télégraphie par Ignace Chappe ; 1 vol. in-8. Paris, 1825, p. 38.
- ↑ Histoire de la télégraphie, page 44, et Mémoires de l’Académie des sciences de Paris, année 1741.
- ↑ Ces curieuses expériences ont été faites à l’aide des tubes cylindriques qui servent à l’écoulement souterrain des eaux de Paris. Au moyen de ces tubes, M. Biot put soutenir une conversation à voix basse avec une personne placée à près d’un kilomètre de distance ; ni lui ni son interlocuteur n’eurent besoin de poser l’oreille sur le tuyau, tant la perception était aisée ; les sons leur parvenaient dans toute leur pureté, on les entendait même deux fois très-distinctement : une fois dans le tube, une autre fois à travers l’air extérieur. « Les mots dits aussi bas que lorsqu’on parle en secret à l’oreille, étaient reçus et appréciés. Des coups de pistolet, tirés à l’une des extrémités, occasionnaient à l’autre une explosion considérable ; l’air était chassé du tuyau avec assez de force pour jeter à plus d’un demi-mètre des corps légers, et pour éteindre des lumières… Enfin, ajoutent les auteurs de cette expérience, le seul moyen de ne pas être entendu à cette distance eût été de ne pas parler du tout. » (Mémoires de la Société d’Arcueil, t. II.)
Jobard a répété et a beaucoup étendu ces expériences. Il fit placer 601 pieds de tubes de zinc de 3 pouces de diamètre dans un vaste atelier. Ces tubes, dont les diverses portions étaient mal jointes, formaient entre eux onze coudes à angle droit : ils montaient et descendaient d’étage en étage ; une partie était suspendue aux murs, une autre couchée sur le plancher. Plusieurs centaines de personnes ont constaté qu’on s’entendait ainsi parfaitement, même en causant à voix basse. Ce dernier fait a mis hors de doute un point que MM. Biot et Hassenfratz n’avaient pas résolu : c’est que le bruit extérieur n’entrave pas les communications acoustiques ; en effet, pendant cette expérience, des machines à vapeur marchaient, des tours, des limes et des marteaux ébranlaient tous les étages de l’atelier, sans nuire aucunement à la perception des sons.
Des ingénieurs distingués ont étudié, en Belgique, la question de l’établissement des tubes acoustiques. On a reconnu que les conditions de succès résident dans la nature des tubes, qui doivent être composés de métaux sonores et dans leur isolement le plus complet possible par rapport au sol. Le gouvernement belge a depuis longtemps accordé l’autorisation d’établir le long des routes des tubes de ce genre. Il n’est pas douteux qu’on ne pût parvenir à correspondre ainsi entre des villes fort éloignées l’une de l’autre. Le savant Babbage se fait fort de causer de Londres avec une personne résidant à Liverpool, qui en est éloignée de 70 lieues. Rumford était plus hardi, il pensait que la voix humaine peut franchir ainsi des centaines de lieues.
- ↑ Lettre de Franklin du 20 juillet 1762.
- ↑ Le télégraphe solaire a été proposé en 1856, par un employé des télégraphes, M. Leseurre. Il repose sur la réflexion des rayons du soleil, projetant à de grandes distances des éclairs lumineux. La répétition de ces éclairs, leur longueur ou leur brièveté, forment un alphabet particulier, qui sert à composer une écriture de convention.
Le télégraphe solaire pourrait servir à établir une correspondance rapide dans les pays où l’installation de la télégraphie électrique présenterait des difficultés ; il s’appliquerait avec de grands avantages en Afrique, pour le service de notre armée.
Comment concevoir que deux observateurs puissent correspondre entre eux par l’envoi réciproque d’éclairs dus à la réflexion des rayons solaires ?
Un faisceau de lumière solaire, réfléchi par un miroir dans une direction déterminée, se transmet, en rase campagne, à une si prodigieuse distance, que toute la difficulté ne peut consister qu’à composer un appareil susceptible de recevoir commodément les éclairs lumineux et pouvant fonctionner pendant toute la durée du jour. Un tel appareil doit pouvoir réfléchir un faisceau lumineux dans une direction quelconque, et l’y maintenir malgré le déplacement du soleil. Il faut ensuite que les éclairs, alternativement provoqués et éteints, constituent des signaux auxquels un sens soit attaché.
Pour obtenir la fixité du faisceau réfléchi, M. Leseurre emploie deux miroirs : l’un est mobile, et suit les mouvements du soleil ; l’autre est fixe. Exposé au soleil, le miroir mobile est incliné sur un axe parallèle à l’axe du monde, et tourne autour de cet axe d’un mouvement uniforme et exactement égal au mouvement de rotation de la terre sur elle-même. Il produit donc l’effet de l’instrument de physique qui a reçu le nom d’héliostat, c’est-à-dire qu’il maintient immobile et dans la même direction le faisceau lumineux, quelle que soit l’inclinaison du soleil sur l’horizon. Le miroir fixe reçoit le faisceau lumineux réfléchi par le miroir mobile, et il l’envoie dans la direction d’une lunette et d’un écran, qui sont disposés pour le recevoir, à la station opposée.
Pour produire un signal lumineux sur l’écran placé à l’une des stations, on imprime au miroir réflecteur un léger mouvement, au moyen d’une simple pression de la main, qui fait agir un petit ressort d’acier. Par ce léger déplacement produit par la main sur le miroir réflecteur, et selon la rapidité de ce déplacement, la station opposée peut recevoir sur son écran des éclairs brefs ou prolongés.
On a donné à ces éclairs, brefs ou prolongés, la même signification que les lignes et les points reçoivent dans le vocabulaire du télégraphe électrique de Morse. On sait que le vocabulaire du télégraphe Morse, aujourd’hui adopté dans toute l’Europe, se compose simplement de lignes et de points. Il a été décidé que les éclairs brefs, dans le télégraphe solaire, représenteraient les points, et que les éclairs prolongés représenteraient les lignes. Avec ces lignes et ces points, on compose un alphabet et une écriture qui suffisent parfaitement à tous les besoins de la correspondance.
Il reste à dire comment, avec le télégraphe solaire, deux personnes, ignorant leur position respective, peuvent se chercher mutuellement et commencer une correspondance.
Voici comment opère le stationnaire qui veut avertir son correspondant et qui ignore sa situation. Il commence par rendre horizontal l’axe de rotation du miroir tournant, et place ce miroir de façon à réfléchir, parallèlement à son axe, la lumière solaire. Cette lumière réfléchie tombe alors sur le deuxième miroir qui est rendu vertical, et qui peut tourner autour d’un axe vertical ; ainsi disposé, ce miroir doit renvoyer successivement vers tous les points de l’horizon la lumière réfléchie par le premier miroir. La zone horizontale qu’éclaire chaque demi-rotation du miroir vertical présente un demi-degré de hauteur. Si l’on craint que quelque point n’ait échappé, on modifie un peu l’inclinaison de l’un des miroirs, et on balaye l’horizon par de nouvelles zones d’éclairs.
Tous ces mouvements sont guidés par l’écran de la lunette, qui accuse à chaque instant la direction du faisceau émergent, et dispense de toute précision. La personne que l’on cherche recevra donc quelques-uns des éclairs, reconnaîtra le point d’où ils partent, s’orientera sur ce point, et lui renverra un feu permanent sur lequel on pourra s’orienter à son tour ; la correspondance régulière pourra alors commencer.
Dans des expériences qui eurent lieu devant M. le maréchal Vaillant, on établit une correspondance très-rapide entre le mont Valérien et la terrasse de la coupole à l’Observatoire. Le même échange de signaux eut encore lieu entre les tours de Saint-Sulpice et la tour de Montlhéry, à une distance de moitié plus considérable.
On a fait une expérience bien plus satisfaisante encore, car on a constaté que lorsque le soleil, voilé par des brumes, s’efface dans le ciel et ne se manifeste plus que par une large zone argentée, le signal lumineux est pourtant toujours sensible à l’œil nu, et se montre très-brillant dans la lunette. Il résulte de là que, même en l’absence du soleil, la correspondance pourrait être continuée.
Le télégraphe solaire n’est pas, comme le télégraphe aérien, un instrument nécessairement fixe et qui exige des stations toujours les mêmes. Il peut s’installer partout. L’instrument portatif, construit par M. Leseurre, ne pèse que 8 kilogrammes. Il se monte sur un trépied en bois, et s’oriente à l’aide d’une boussole et d’un niveau à bulle d’air. Il n’occupe guère plus de volume qu’un héliostat, avec lequel il a beaucoup de ressemblance. Il est surtout remarquable par la facilité qu’on a de le transporter d’un endroit dans un autre, par le peu d’embarras qu’il cause et le peu de temps qu’il exige pour être installé et mis en place.
- ↑ Ces procès-verbaux sont rapportés dans l’Histoire de la télégraphie d’Ignace Chappe, note 7, pages 234-242.
- ↑ Moniteur universel. Séance de l’Assemblée législative du 22 mars 1792.
- ↑ Éd. Gerspach, Histoire administrative de la télégraphie aérienne en France, in-8o, Paris, 1861, page 16.
- ↑ Exposé sommaire des travaux de J. Lakanal, 1 vol. in-8o. Paris, 1838, pages 220, 221.
- ↑ Exposé sommaire des travaux de J. Lakanal, 1 vol. in-8o, Paris, 1838, pages 220, 221.
- ↑ Gerspach, Histoire administrative de la télégraphie aérienne en France. in-8o, Paris, 1861, page 21.
- ↑ Travaux de Lakanal. Paris, 1838, in-8, p. 105-115.
- ↑ É. Gerspach, Histoire de la télégraphie aérienne en France, p. 28.
- ↑ É. Gerspach, Histoire administrative de la télégraphie aérienne en France, p. 33.
- ↑ Ibidem, p. 33.
- ↑ É. Gerspach, Histoire administrative de la télégraphie aérienne en France, p. 37.
- ↑ É. Gerspach, Histoire administrative de la télégraphie aérienne en France, p. 47.
- ↑ É. Gerspach, p. 51.
- ↑ É. Gerspach, Histoire administrative de la télégraphie aérienne en France, p. 60.
- ↑ É. Gerspach, p. 58.
- ↑ Idem, p. 63.
- ↑ É. Gerspach, Histoire de la télégraphie aérienne en France, p. 73.
- ↑ É. Gerspach, p. 74.
- ↑ É. Gerspach, Histoire de la télégraphie aérienne en France, p. 81.
- ↑ Pages 93-95.
- ↑ Dans une brochure publiée en 1842, sous le titre de Télégraphe de jour et de nuit et sur laquelle nous reviendrons bientôt, M. Chatau donne les détails suivants sur la disposition qu’il a adoptée en Russie pour éclairer le télégraphe pendant la nuit.
« Mes lanternes et mes feux ne laissent rien à désirer. L’huile est le seul combustible employé. Les réservoirs sont à l’abri des froids les plus intenses. Les lampes sont à niveau constant, à mèche plate. Le foyer lumineux ne craint ni la pluie, ni le vent le plus violent, ni les mouvements les plus rapides du télégraphe. Ce foyer se maintient à un degré d’éclat suffisant durant vingt heures, sans demander aucun soin, pourvu qu’on emploie de l’huile bien épurée et de bonnes mèches. Bien que la largeur des mèches ne soit que de 12 millimètres, tous les signaux sont distingués à la distance de 30 kilomètres ; ainsi on obtient une très-bonne transmission à 12 kilomètres, la plus grande distance qui doive exister sur une ligne télégraphique.
« Si une lanterne s’éteint, le stationnaire le sait à l’instant, et cette lanterne est bientôt rallumée ; mais un pareil accident est extrêmement rare avec mon télégraphe, et je doute qu’il arrive trois fois par an sur une ligne de cent cinquante postes. Les lanternes portent un signe qui indique le côté de Varsovie ; chacune d’elles a, excepté aux postes extrêmes, deux réverbères, deux réservoirs et deux foyers… Si un verre se casse (ce qui arrive très-rarement), il faut quinze secondes pour enlever la porte dont le verre est cassé, et quinze secondes pour mettre une nouvelle porte qui est toujours prête ; mais les verres sont à l’abri de tout accident, une fois que mes lanternes sont posées au télégraphe. Quelle que soit la rapidité des mouvements du télégraphe, aucune lanterne ne peut s’ouvrir, ni se détacher, ni donner contre un poteau. »
- ↑ Pages 167-169.
- ↑ Télégraphe de jour et de nuit par Pierre-Jacques Chatau. Paris, 1842, grand in-8o, avec 3 planches gravées.
- ↑ É. Gerspach, Histoire administrative de la télégraphie aérienne en France, p. 87.
- ↑ Page 110.
- ↑ Gerspach, ouvrage cité, p. 112.
- ↑ Langue musicale universelle inventée par François Sudre, également inventeur de la Téléphonie musicale. 1866, 1 vol. in-12, contenant le Vocabulaire de la langue musicale (imprimé à Tours).
- ↑ L’édition française du code Reynold a pour titre : Code international. Télégraphie nautique réglementaire pour les bâtiments de guerre et de commerce français acceptée par les gouvernements d’Angleterre, des Pays-Bas, de Sardaigne, de Suède, de Grèce, de Naples, de Belgique, de Prusse, de Norwège, de Russie, de l’Uruguay, de Hambourg, d’Oldenbourg, du Chili, de Danemark, d’Autriche, etc., etc., publiée sous les auspices et par les ordres de S. Exc. M. le Ministre de la marine et des colonies, par Charles de Reynold de Chauvancy, capitaine de port, 4e édition. Paris, 1857, chez L. Hachette.
- ↑ Code commercial de signaux maritimes à l’usage des bâtiments de toutes les nations, Paris, in-8o, 1866, chez Galignani.
- ↑ Code Reynold, pp. XLII, XLIII.
Extrait de wikisourse