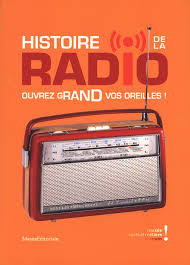Après Volta, qui trouva la pile électrique et son courant, après OErsted, qui découvrit l’action du courant sur l’aiguille aimantée, viennent les travaux de M. Arago, qui reconnut que le courant produisait des aimants très énergiques par son action sur des barreaux de fer doux entourés de fils conducteurs de l’électricité. Une fois en possession de cette énergique action, la télégraphie électrique a tout osé. Elle a fait parcourir à des aiguilles analogues à des aiguilles de montre les divers points d’un cadran où sont écrits les lettres et les chiffres que l’on veut indiquer à son correspondant. Ce que le courant fait à Paris, il le fait à Marseille, et l’indication du cadran de Paris se répète fidèlement à mille, à deux mille, à trois mille kilomètres. Bien plus, comme l’aimant instantané produit dans l’expérience de M. Arago peut être rendu plus ou moins énergique à volonté, on peut développer assez de force pour faire imprimer la lettre que l’on a amenée devant le papier à dépêches, ou bien on peut marquer sur ce papier des points, des traits, des combinaisons de ces deux signes, soit avec de l’encre, soit à la pointe sèche en rayant ou perçant le papier ; en un mot, l’action de l’aimant qui peut tirer, pousser, frapper, presser, etc., doit être considérée comme l’action d’une main que l’on pourrait étendre de Paris à Marseille ou de New-York à la Nouvelle-Orléans, c’est-à-dire à plusieurs mille kilomètres de distance.
On peut facilement imaginer que les premiers principes de Volta, d’OErsted, d’Arago une fois livrés au public, la spéculation industrielle s’en empara, et épuisa tout ce que le génie de l’homme, activé par la beauté du sujet ou par le mobile de l’intérêt, peut inventer de plus ingénieux et de plus utile. Ce serait la matière de plusieurs volumes, que d’essayer de faire connaître, même sommairement, tout ce qui a été fait dans ce genre et tout ce qu’on y ajoute journellement. Dans l’état actuel de la télégraphie électrique, on peut, pour quelques centaines de francs, se procurer le plaisir d’établir dans son domaine, entre deux bâtiments même fort éloignés, deux postes télégraphiques à cadrans avec des sonneries pour avertir qu’on veut correspondre ou transmettre des ordres, ces transmissions se faisant par des indications de lettres et de chiffres ordinaires qui n’offrent aucune difficulté à envoyer ou à recevoir et à lire.
Après les États-Unis, où la télégraphie électrique a dû prendre un prodigieux développement, puisque, cette nation a un continent tout entier pour territoire, c’est en Angleterre, dans un territoire au contraire très peu étendu, que l’activité commerciale a considérablement développé l’emploi du télégraphe électrique. Commençons cependant par la France.
Ce n’est guère que depuis 1850 que notre pays est entré sérieusement dans la voie de la télégraphie électrique. Cette belle branche de la science et de l’industrie y prend aujourd’hui un rapide développement. Strasbourg, Lyon, Marseille, Bordeaux, Nantes, le Havre, Calais, Dieppe, Toulouse, sont atteints, et de semaine en semaine, d’après le magnifique plan mis en exécution par notre belle administration télégraphique française ; l’année 1853 ne se terminera point sans qu’on ait relié à Paris tous les chefs-lieux des départemens au moins par deux communications électriques. L’École polytechnique, appelée par ses élèves à concourir au perfectionnement de cette télégraphie scientifique, y imitera, comme elle l’a déjà fait dans d’autres services publics, la sève vigoureuse d’une instruction supérieure. Je ne puis oublier les services d’un savant et d’un praticien de premier ordre, M. Bréguet, qui a construit tout le matériel de France et celui de quelques autres états. M. Bréguet a su répondre dans ses constructions à toutes les exigences du service français, qui n’admet rien que de complètement satisfaisant, tandis qu’en Amérique on se contente trop souvent d’approximations éloignées vers la perfection. Dans les nombreuses relations que j’ai pu avoir avec les chefs de corps qui dirigent tous les genres de services publics à l’étranger, j’ai toujours trouvé qu’ils reconnaissent la supériorité de marche et la capacité de nos services et de nos établissements français, et je pense que pour la télégraphie électrique comme pour le reste, rien ne se fait hors de France avec plus de sûreté, de régularité, de probité, ou, en un mot, avec plus d’honneur.
Les signaux transmis en Angleterre par l’agitation d’une ou de deux aiguilles aimantées sont sujets à être troublés par des courants produits par des circonstances météorologiques, des orages, des aurores boréales ou de petites convulsions intérieures de la terre, peut-être même par les brusques variations de la température. En France, on fait exclusivement usage du télégraphe à aiguilles non aimantées et donnant leurs indications sur un cadran portant des lettres. Comme on est obligé de passer sur ces vingt-six lettres ou chiffres pour faire le tour du cadran, on a obtenu une accélération notable en ne mettant que huit indications sur le cadran, en sorte qu’en prenant un double cadran on a huit fois huit, c’est-à-dire soixante-quatre indications, ce qui dépasse tous les besoins de l’alphabet. Comme on opère des deux mains, la rapidité de transmission et de lecture devient très grande dans ce cas, et peut atteindre, dit-on, près de deux cents lettres à la minute ; mais dans l’usage ordinaire et avec la sûreté qu’exige le service français, soixante lettres par minute sont déjà une vitesse de transmission considérable, et c’est plutôt la difficulté de lire que celle d’écrire qui arrête la rapidité des communications, quoique certains employés lecteurs arrivent à une promptitude de perception vraiment inconcevable.