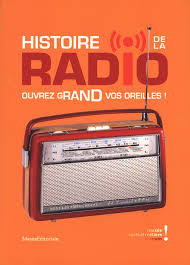A la fin du 19ème siècle, la T.S.F. (télégraphie sans fil) a pris son essor et voit ses domaines d’application se multiplier ; la diffusion de signaux horaires bénéficie de ces progrès pour s’effectuer sur des distances de plus en plus grandes. Les lignes qui suivent ont essentiellement été tirées d’un très vieil ouvrage du début de la TSF, il faut donc se replacer et s’imaginer être en 1914.
Par Jean-Luc Desgrez – F5NKK
Suite de la partie 5
Dans la région de Paris, avec un poste de réception à courte distance (figure 4), la réception des signaux horaires aura donc lieu à dix heures et à minuit.

Figure 4 – Récepteur à galène mural
Quant aux modes d’émission des signaux(4), ceux-ci sont faits dans les trois dernières minutes de l’heure qui précède l’heure indiquée par des séries de points et de traits. Voici les raisons qui ont milité en faveur de cette combinaison.
Evidemment, un point bref et sec est un signal facile à percevoir et à noter exactement, surtout quand on est prévenu de son arrivée imminente par une série de signaux dits « d’avertissement ».
Mais nous avons vu qu’il existe en permanence, dans l’atmosphère, des signaux parasites dus aux orages, aux manifestations électriques, aux courants telluriques et à d’autres causes sans doute inconnues ou même insoupçonnées. Le résultat pratique de ces causes dépendantes d’ondes diverses se traduit, dans le téléphone, par des crachements, des bruits rauques, analogues aux bruit de « friture » des téléphones. Ces crachements, secs et brefs eux-mêmes, peuvent parfaitement masquer les signaux formés eux-mêmes d’un point sec et bref, tandis qu’ils ne masqueront pas un trait, d’une durée d’une seconde, qui continuera d’être perçu nettement, surtout s’il provient d’un poste à émission musicale, c’est-à-dire donnant une note de hauteur donnée. L’opérateur apprécie alors soit le commencement, soit la fin du trait, et si celui-ci dure exactement une seconde, l’appréciation du signal horaire se fait avec toute la précision désirable.
ENVOI AUTOMATIQUE DES SIGNAUX HORAIRES : Quand la Conférence de l’heure décida d’émettre des signaux horaires suivant la figure 5, il devint évident qu’il était difficile de charger un observateur unique d’émettre, à la main, cette longue série de signaux : cela eût exigé de lui qu’il observât, d’une part, la pendule et que, d’autre part, il actionnât un manipulateur, il fallait que la précision soit indépendante de la nervosité de celui qui était chargé d’envoyer le signal manuellement. Il fut donc décidé que des appareils spéciaux seraient mis à l’étude, pour permettre à la pendule directrice de l’Observatoire d’envoyer elle-même, automatiquement, les signaux radiotélégraphiques suivant la règle adoptée pour le service international de l’heure.

Figure 5 – Schéma d’envoi des signaux horaires
(4) – L’heure exacte, donnée à la fin de la cinquante-neuvième seconde ou, ce qui revient au même, au commencement de la soixantième, est toujours indiquée par la fin d’un signal de cinq secondes, fait par trois traits (signaux longs, durant une seconde) séparés l’un de l’autre par un intervalle d’une seconde. De 9h 57mn à 9h 57mn 50s, on n’entend que des signaux dits d’avertissement, envoyés à la main et réglés par le rythme suivant : ── ▪ ▪ ── ── ▪ ▪ ── ── ▪ ▪ ── ; etc..
Ces signaux cessent à 9h 57mn 50s ; silence de cinq secondes, et trois traits d’une seconde chacun ; la fin du dernier trait indique qu’il est exactement 9h 58mn 0s. Il y a ensuite un silence de huit secondes, après lequel commencent les signaux de la cinquante-huitième minute, dont voici le rythme : ── ▪ (8 secondes) ── ▪ (8 secondes) ── ▪ ; etc.. jusqu’à 9h 58mn 50s ; silence de cinq secondes, et trois traits d’une seconde chacun : la fin du dernier trait annonce qu’il est exactement 9h 59mn 0s. Enfin commencent les signaux qui doivent donner l’heure « ronde » : à 9h 59, silence de six secondes ; puis viennent les signaux dont chacun dure quatre secondes ainsi rythmés : ── ── ▪ (6 secondes) ── ── ▪ (6 secondes) ; etc.. L’espacement entre deux traits, ou entre un trait et le point, est toujours d’une seconde, et les intervalles entre deux groupes consécutifs, de six secondes. Comme les précédents, les signaux cessent à la cinquantième seconde ; à 9h 59mn 55s, l’horloge envoie les trois derniers traits : 1sec 1sec 1sec
─── 1sec ─── 1sec ───
Et c’est la fin du dernier qui nous indique qu’il est exactement 10 heures, si c’est le matin, ou minuit si c’est le soir.
A suivre …