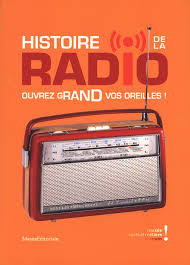TROISIÈME PARTIE
 Le physicien français Amontons découvre le système de télégraphie moderne. — autres projets de télégraphie aérienne.
Le physicien français Amontons découvre le système de télégraphie moderne. — autres projets de télégraphie aérienne.
La France, on a pu le remarquer, n’avait encore fourni aucun contingent à l’ordre de travaux qui nous occupent. Il faut donc nous empresser d’ajouter qu’un physicien français du 177ème siècle, Guillaume Amontons, eut le mérite, peu de temps après Robert Hooke, c’est-à-dire en 1690, de découvrir la méthode qui sert de base à la télégraphie aérienne moderne. C’est en effet Amontons qui, le premier, se servit d’une lunette pour observer les signaux formés dans l’espace, et servant à établir une correspondance entre deux points éloignés.
Dans l’Éloge d’Amontons, Fontenelle a décrit, avec assez d’exactitude, la découverte d’Amontons, qui consistait à se servir de lunettes d’approche pour observer les signaux transmis par des postes fixes.
« Peut-être, dit Fontenelle, prendra-t-on pour un jeu d’esprit, mais du moins très-ingénieux, un moyen qu’il inventa de faire savoir tout ce qu’on voudrait à une très-grande distance, par exemple de Paris à Rome, en très-peu de temps, comme en trois ou quatre heures, et même sans que la nouvelle fut sue dans tout l’espace d’entre-deux. Cette proposition, si paradoxe et si chimérique en apparence, fut exécutée dans une petite étendue de pays, une fois en présence de Monseigneur, et une autre en présence de Madame. Le secret consistait à disposer dans plusieurs postes consécutifs des gens qui, par des lunettes de longue vue, ayant aperçu certains signaux du poste précédent, les transmissent au suivant, et toujours ainsi de suite, et ces différents signaux étaient autant de lettres d’un alphabet dont on n’avait le chiffre qu’à Paris et à Rome. La plus grande portée des lunettes faisait la distance des postes, dont le nombre devait être le moindre qu’il fût possible ; et comme le second poste faisait des signaux au troisième à mesure qu’il les voyait faire au premier, la nouvelle se trouvait portée à Rome presque en aussi peu de temps qu’il en fallait pour faire les signaux à Paris. »
La théorie et la pratique du télégraphe aérien moderne se trouvent contenues, on peut le dire, dans le système d’Amontons, qui fut d’ailleurs, comme nous allons le raconter, soumis à une expérience publique.
Amontons était un des physiciens les plus habiles du 17ème siècle. Ses travaux relatifs au thermomètre à air, au baromètre et à l’hygrométrie, ont exercé sur les progrès de la physique une influence puissante. Il était né inventeur. Mais s’il avait le génie qui dicte les découvertes, il était loin de réunir les qualités d’esprit qui font le succès et la fortune des inventions. Hors de ses livres et de ses machines, c’était l’homme le plus gauche et le plus ennuyeux du monde.
Ajoutez qu’il était sourd. Il ne voulut jamais essayer de guérir sa surdité. « Il se trouvait bien, dit Fontenelle, de ce redoublement d’attention et de recueillement qu’elle lui procurait, semblable en quelque chose à cet ancien qui se creva les yeux pour n’être pas distrait dans ses méditations philosophiques. »
Ceci était admirable pour faire des découvertes, mais peu avantageux pour les propager au dehors. Aussi est-il probable que la machine à signaux qu’il imagina vers 1690 serait restée à jamais inconnue, si le hasard ne s’en était mêlé.
Mademoiselle Chouin, maîtresse du premier dauphin, fils de Louis 14, entendit parler, à Versailles, de la découverte d’Amontons.
En sa qualité de favorite, mademoiselle Chouin avait ses caprices ; elle eut la fantaisie de voir fonctionner la machine du savant. Mais mademoiselle Chouin avait d’autres qualités : elle avait du cœur, elle s’intéressa à la fortune du pauvre inventeur. Elle ne manquait pas d’ailleurs, d’un certain esprit d’intrigue ; ce qui fit qu’en dépit de l’indolence et de l’apathie du dauphin, elle obtint de lui la promesse d’une expérience publique.

L’expérience eut lieu dans le jardin du Luxembourg, mais elle tourna fort mal. La présence du dauphin, les brillants costumes des seigneurs qui l’entouraient, tout cet étalage solennel et inusité, troublèrent le savant.
Sa surdité augmentait son embarras et sa confusion. Il manœuvra tout de travers et ne put transmettre aucun signal. Le prince se mit à bâiller, tous les courtisans l’imitèrent, et la séance se termina sur cette triste impression.
Cependant mademoiselle Chouin ne se découragea pas. Elle obtint une seconde épreuve qui se fit en présence de la dauphine. Cette fois les choses marchèrent mieux, mais tout le crédit de la favorite ne put aller plus loin. Que pouvait-elle obtenir de plus de la nullité d’un prince, qui, au rapport de Saint-Simon, depuis qu’il était sorti des mains de ses précepteurs, « n’avait, de sa vie, lu que l’article Paris dans la Gazette de France, pour y voir les mariages et les morts » ?
Amontons, découragé, abandonna sa découverte. Il se consola de cet échec, en prenant place, quelques années plus tard, sur les bancs de l’Académie des sciences.
On a beaucoup vanté les encouragements et les honneurs qui furent accordés sous Louis 14 aux lettres et aux beaux-arts. Il faudrait ajouter, pour tout dire, que les sciences participaient rarement de ces hautes faveurs. Quand Louis 14 eut fondé l’Académie, lorsqu’il l’eut installée au Louvre, et qu’il eut ainsi fait aux académiciens la politesse royale de les recevoir chez lui, il se crut suffisamment acquitté envers la science. Cinq ou six pensions accordées à quelques savants bien en cour, adulateurs émérites de la trempe de Fontenelle ou de Fagon ; en de rares occasions quelques visites solennelles aux académiciens assemblés : voilà à peu près à quoi se réduisit la protection du grand roi. On cesse d’être surpris de la lenteur qu’a présentée, au 17ème siècle, le développement des sciences, quand on songe qu’elles avaient Louis 14 pour protecteur.
On vient de voir comment fut accueillie l’idée d’Amontons, qui renfermait le germe de la télégraphie moderne ; quelques années après, un autre inventeur se présenta avec une découverte semblable, et il ne fut pas mieux traité.
Cet autre inventeur s’appelait Guillaume Marcel ; il occupait à Arles la place de commissaire de la marine. Après plusieurs années de recherches, il était parvenu à construire une machine qui transmettait des avis dans le seul intervalle de temps qu’il aurait fallu pour les écrire. Les expériences faites à Arles, et dont le procès-verbal existe encore, ne laissent aucun doute à cet égard. Les mouvements de la machine s’exécutaient, dit-on, avec une rapidité égale à la pensée. En outre, l’appareil fonctionnait de nuit aussi bien que de jour ; il représentait donc le phénix tant cherché de la télégraphie nocturne.
L’inventeur se refusa à publier sa découverte ; il voulut d’abord la mettre sous l’invocation et la protection du roi.
Marcel avait déjà servi Louis 14. Avocat au conseil, il avait suivi M. Girardin à l’ambassade de Constantinople. Nommé ensuite commissaire près du dey d’Alger, il y conclut le traité de 1677, qui rétablit nos relations commerciales dans le Levant.
C’est en récompense de ces services qu’il avait obtenu la place de commissaire de la marine à Arles.
Il voulut donc présenter au roi l’hommage et les prémices de son invention : il lui adressa un mémoire descriptif avec les dessins de son appareil. Il ne demandait rien d’ailleurs, et sollicitait seulement le transport de sa machine à Paris.
Ce mémoire resta sans réponse ; le roi était vieux, il commençait à négliger, pour les choses du ciel, son royaume terrestre.
Marcel écrivit lettres sur lettres aux ministres ; mais Colbert n’était plus là, il n’y avait que Chamillard, et le pauvre homme avait assez à faire avec la coalition européenne à combattre, et madame de Maintenon à ménager.
Marcel attendit longtemps. Un jour, fatigué d’attendre et dans un moment de désespoir, il brisa sa machine et jeta au feu ses dessins. À quelques années de là, il mourut, emportant son secret. Il ne laissa ni plan, ni description de ses instruments, et l’on ne trouva dans ses papiers que son Livre des signaux (Citatæ per aera decursiones), dont sa femme et un de ses amis avaient seuls la clef.
Le nom de Guillaume Marcel est à peu près oublié aujourd’hui, ou du moins il n’est resté attaché qu’à quelques ouvrages qu’il a laissés concernant l’histoire sacrée ou profane, et la chronologie.
C’était le premier chronologiste de son siècle. Il réunissait toutes les qualités de l’état, car sa mémoire tenait du prodige. Le Journal des savants de 1678 (où il est désigné, par erreur typographique, sous le nom de Marcet) nous apprend qu’il « faisait faire l’exercice à un bataillon, nommant tous les soldats par le nom qu’ils avaient pris en défilant une fois devant lui », et qu’il exécutait de mémoire une opération d’arithmétique, fut-elle de trente chiffres. On ajoute qu’il dictait à la fois à plusieurs personnes en six ou sept langues différentes.
L’histoire des premiers essais de la télégraphie nous amène à parler des expériences de télégraphie acoustique qui furent faites en France vers la fin du siècle dernier.
Le 1er juin 1782, l’Académie des sciences tenait sa séance au Louvre, lorsque l’on vit entrer, conduit par Condorcet, un moine, revêtu de la robe des bénédictins.
C’était dom Gauthey, religieux de l’abbaye de Cîteaux. Dans les loisirs du cloître, il avait imaginé un moyen de correspondance entre les lieux éloignés, et il venait en faire l’exposition devant l’Académie.
Dom Gauthey avait vingt-cinq ans à peine : il était d’une taille élevée, et son visage était empreint d’une douceur et d’un charme inexprimables.
Quand il prit la parole pour faire connaître les principes de son invention, son élocution contenue et grave produisit sur la docte assemblée l’effet le plus heureux. Son succès fut complet ; il dépassa bientôt les limites de l’enceinte académique. Pendant quelques jours le jeune bénédictin fut le héros de la cour et de la ville. Condorcet écrivit à ce sujet un rapport à l’Académie des sciences, dont voici le texte.
« Nous avons examiné, par ordre de l’Académie, un mémoire présenté par dom Gauthey, religieux de l’ordre de Cîteaux, contenant un moyen de communiquer entre deux endroits très-éloignés ; ce moyen, dont l’auteur s’est conservé le secret, nous a été communiqué, et il nous a paru praticable et ingénieux : il peut s’étendre jusqu’à la distance de treize lieues sans stations intermédiaires, et sans appareil trop considérable. Quant à la célérité, il n’y aurait que quelques secondes d’une ligne à l’autre. Mais le temps dont on aurait besoin pour faire entendre le premier signe serait plus long, et ne peut être connu que par l’expérience ; et cette expérience serait peu coûteuse.
Il n’est guère possible sans l’avoir faite de déterminer, même à peu près, les frais de construction de la machine. Nous pouvons assurer seulement que si la distance était très-petite, comme celle du cabinet d’un prince à celui de ses ministres, l’appareil ne serait ni trop cher ni très-incommode, et qu’on pourrait répondre du succès.
« Le moyen nous a paru nouveau, et n’avoir aucun rapport aux moyens connus et destinés à remplir le même objet.
« Nous déposons au secrétariat de l’Académie un papier contenant le mémoire de dom Gauthey et les motifs de notre opinion sur la possibilité du moyen qu’il propose.
« Fait au Louvre, ce samedi 1er juin 1782. »
Le système de dom Gauthey consistait à établir, entre des postes successifs, des tubes métalliques d’une très-grande longueur, à travers lesquels la voix se propageait sans perdre sensiblement de son intensité. Dom Gauthey affirmait pouvoir transmettre ainsi, dans une heure, un avis à deux cents lieues de distance.
Louis 16 voulut que le procédé de dom Gauthey fût soumis à l’expérience demandée par Condorcet. Cette expérience eut lieu, sur une longueur de huit cents mètres, dans un des tuyaux qui conduisaient l’eau à la pompe de Chaillot. Elle ne laissa aucun doute sur la vérité des assertions de dom Gauthey.

À la suite de ce premier essai, l’inventeur demanda l’épreuve de son système acoustique sur une échelle plus étendue. Il proposait de poser des tubes enchâssés les uns dans les autres, de manière à former un tuyau non interrompu, et prétendait, avec trois cents tuyaux de mille toises chacun, faire passer, en moins d’une heure, des dépêches à cent cinquante lieues. Cependant cette expérience fut jugée ruineuse, et la munificence royale recula devant les dépenses qu’elle devait entraîner.
Dom Gauthey se tourna alors d’un autre côté. Il ouvrit une souscription, mais elle fut insuffisante pour couvrir les frais probables de l’entreprise.
Pendant cet intervalle, l’engouement du public avait disparu. Dans cette société frivole, les impressions se formaient et s’effaçaient avec la même promptitude.
Le caprice d’un jour avait élevé la fortune du jeune bénédictin, elle s’envola au premier souffle contraire. Au bout de six mois, dom Gauthey était si parfaitement oublié, qu’il ne put trouver en France un imprimeur qui consentît à publier, même à prix d’argent, l’exposé de son système.
En désespoir de cause, le pauvre inventeur s’embarqua l’année suivante, pour l’Amérique. Il y fit connaître sa découverte et demanda des souscriptions. Mais il ne put trouver qu’un imprimeur, qui voulût bien publier son Prospectus, lequel parut à Philadelphie en 1783.
Les idées de dom Gauthey étaient cependant beaucoup plus rationnelles qu’on ne le penserait peut-être au premier aperçu. Rien n’indique, dans la théorie mathématique du mouvement de l’air, que le son doive s’affaiblir en parcourant de longs tuyaux ; aussi est-il probable que les expériences de dom Gauthey reprises sérieusement amèneraient d’utiles résultats. Le son parcourt trois cent quarante mètres par seconde, ou trois cent six lieues par heure ; on conçoit donc que, s’il peut se transmettre sans s’altérer dans des tuyaux cylindriques, on pourrait obtenir, en disposant un certain nombre de postes aux distances convenables, un moyen de correspondance qui ne serait pas sans valeur.
Non-seulement, en effet, les tubes propagent très-bien le son, mais ils en accroissent singulièrement la puissance. Un coup de pistolet tiré à l’une des extrémités d’un tube fait entendre à l’autre extrémité le bruit du canon. Jobard a reconnu que le mouvement d’une montre, qui n’est pas sensible à la distance de 16 centimètres, s’entend très-bien au bout d’un tuyau métallique de 16 mètres, sans que la montre touche le métal et même lorsqu’elle en est éloignée de plusieurs pieds. Dom Gauthey avait déjà reconnu le même fait avec un tuyau de cent dix pieds.
MM. Biot et Hassenfratz ont fait des expériences plus décisives encore et qui confirment parfaitement les faits avancés par le moine de Cîteaux. Ils ont reconnu qu’à travers les tubes souterrains, la voix se propage sans rien perdre de son intensité à un kilomètre de distance[7].
Le son peut d’ailleurs se transporter à des distances considérables sans l’intermédiaire d’aucun conducteur. Le docteur Arnoldt raconte que pendant son retour d’Amérique en Europe, à bord du paquebot, tout à coup un matelot s’écria qu’il entendait le son des cloches. Ceci fit beaucoup rire l’équipage : on était à cent lieues de la côte. Cependant le docteur prit la chose plus au sérieux.
Il remarqua qu’il régnait une brise de terre assez forte, et que dans ce moment la voile du vaisseau était concave. Il se plaça au foyer de la voile et entendit parfaitement la volée des cloches. Il tint note du jour et de l’heure. Six mois après, de retour en Amérique, il apprit qu’au jour et à l’heure qu’il avait notés, il y avait eu à Rio-Janeiro un branle-bas des cloches à l’occasion de la fête de la ville.
Un autre jour, le docteur Arnoldt, se trouvant sur le bord d’un lac de sept lieues de large, entendit, d’une rive à l’autre, le cri des marchands d’huîtres et le bruit des rames.
Selon Franklin, les globes de feu formés par des météores à plus d’une lieue d’élévation dans les airs, produisent, en éclatant à cette hauteur, un bruit que l’on entend sur terre à vingt-cinq lieues à la ronde. Le traducteur de Franklin ajoute qu’il a lui-même entendu à Paris des coups de canon tirés à Lille.
C’est d’après ces faits que quelques personnes ont proposé d’établir des télégraphes au moyen du langage parlé. Il serait facile, selon le docteur Arnoldt, de créer un service télégraphique fondé sur ce principe. Tout l’appareil consisterait en une sorte de miroir métallique concave, placé sur une éminence à l’une des extrémités de la ligne ; à quelques lieues de là, à l’autre extrémité de la ligne, un porte-voix parabolique serait dirigé vers cette surface.
On recueillerait les sons envoyés par le porte-voix en se plaçant au foyer du miroir. Ce serait là évidemment un moyen de correspondance fort peu dispendieux. Malheureusement la démonstration pratique a manqué jusqu’ici au système proposé par le docteur Arnoldt.
Le désir de justifier les idées de dom Gauthey, nous a entraîné à une digression un peu longue. Revenons à la série des essais télégraphiques.
(texte extrait de Wki Source)