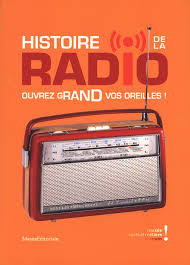A la fin du 19ème siècle, la T.S.F. (télégraphie sans fil) a pris son essor et voit ses domaines d’application se multiplier ; la diffusion de signaux horaires bénéficie de ces progrès pour s’effectuer sur des distances de plus en plus grandes. Les lignes qui suivent ont essentiellement été tirées d’un très vieil ouvrage du début de la TSF, il faut donc se replacer et s’imaginer être en 1914.
Par Jean-Luc Desgrez – F5NKK
Suite de la partie 2
L’HEURE UNIVERSELLE : La forme même de la terre, qui est, à très peu de choses près, une sphère, le mouvement de rotation dont elle est animée autour de son axe, font que chaque point de celle-ci défile à son tour devant le soleil. Au moment où il passe devant l’astre, il est midi vrai, et il en résulte forcément qu’il ne peut être midi que pour un seul point de la terre à la fois. Chaque point du globe a donc son heure locale ; quoi que l’on puisse faire ou penser, quand il est midi à Paris, il y a cinquante-cinq minutes que la ville de Vienne, en Autriche, est passée devant le soleil au cours du mouvement diurne de la terre, et il ne peut être à la fois midi dans ces deux villes.
Tant que les communications entre les peuples furent peu rapides, tant que les voyages sur terre se faisaient par des véhicules se déplaçant lentement, ayant leurs itinéraires indépendants les uns des autres et assez clairsemés sur les routes, on se contenta de l’heure locale de chaque endroit. Mais quand l’invention et la généralisation des chemins de fer vinrent poser le problème de la circulation rapide des trains sur une voie unique, il fallut songer à unifier l’heure des diverses stations. Ce fut l’époque où l’on avait, dans chaque ville de France, deux « heures » différentes : l’ « heure de la ville »(2) et l’ « heure de la gare », qui était celle de Paris, transmise télégraphiquement. L’heure de la ville avançait sur l’heure de la gare pour les stations situées à l’Est de Paris ; elle retardait pour les stations situées à l’Ouest. La différence des heures n’était pas d’ailleurs sans atteindre une valeur relativement importante pour les points extrêmes du territoire : elle atteignait vingt-sept minutes à Brest et vingt minutes, en sens contraire, à Nice.
Les inconvénients de cette double numération furent si manifestes que, dès l’année 1891, une loi rendit réglementaire pour toute la France l’heure de Paris. Les divers Etats du monde avaient d’ailleurs pris des mesures analogues, chacun pour l’étendue de son territoire. Cela allait très bien tant qu’on ne sortait pas d’un pays déterminé, mais l’inconvénient devenait grave quand il fallait passer d’un pays à un autre et pour en citer un cas typique et demeuré classique, sur le bord du Lac de Constance, dont les rives baignent cinq Etats différents : la Suisse, le Duché de Bade, la Bavière, la Wurtemberg et l’Autriche, on ne comptait pas moins de cinq heures différentes ! De là une confusion, tout au moins une complication extrême, dans les horaires des bateaux et des chemins de fer.
Ainsi l’heure nationale, suffisante pour un même pays de peu d’étendue, devient insuffisante quand il s’agit de plusieurs états ; elle le devient même pour un seul pays, si l’étendue de celui-ci de l’Est à l’Ouest est considérable. C’est le cas pour les Etats-Unis d’Amérique, pour l’Empire Russe sur l’ancien continent : pour ce dernier pays, il serait midi à l’est de la Sibérie, quand il ne serait que deux heures du matin à Saint-Petersbourg : une heure unique y serait donc en contradiction avec les conditions mêmes de la vie, conditions réglées sur le lever et le coucher du soleil.
2)– Jusqu’en 1891, chaque ville de France avait sa propre heure calculée par rapport à la position du soleil : il s’agissait de l’heure solaire aussi appelée « heure vraie ».
A suivre …