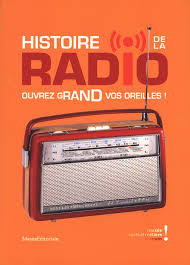A la fin du 19ème siècle, la T.S.F. (télégraphie sans fil) a pris son essor et voit ses domaines d’application se multiplier ; la diffusion de signaux horaires bénéficie de ces progrès pour s’effectuer sur des distances de plus en plus grandes. Les lignes qui suivent ont essentiellement été tirées d’un très vieil ouvrage du début de la TSF, il faut donc se replacer et s’imaginer être en 1914.
Par Jean-Luc Desgrez – F5NKK
Suite de la partie 3
LES FUSEAUX HORAIRES : En présence de l’impossibilité de trouver une heure vraiment « universelle », on pensa alors à se plier aux exigences solaires : puisque les points de la terre défilent en vingt-quatre heures devant le soleil, divisons le globe, comme un énorme melon, en vingt-quatre tranches égales ; décidons que, dans chacune de ces tranches, on emploiera une seule heure, celle de son méridien central. Dans ces conditions, quand on passera d’un fuseau à un autre, la différence sera exactement d’une heure « ronde ». Il suffira d’avancer ou de reculer d’une heure exactement la petite aiguille de sa montre : la grande aiguille restera en place, et les minutes seront les mêmes sur toute l’étendue de la terre.
C’est ce système, appelé système des fuseaux horaires, qui a prévalu pour l’heure universelle : la France l’a adopté officiellement depuis la loi du 9 mars 1911(3).
La carte à la figure 3 en montre la réalisation sur la surface de la terre entière. Chaque fuseau occupe 15° de longitude et prend l’heure du méridien qui est en son centre, le méridien originaire étant celui de Greenwich. Les pays de petite ou moyenne étendue adoptent, pour les territoires, l’heure du fuseau correspondant ; ceux qui sont coupés par plusieurs fuseaux répartissent leurs provinces suivant les diverses heures des fuseaux qui en coupent la surface la plus grande.

Figure 3 – Carte des fuseaux horaires
Mais il restait à « réaliser » cette conception de l’heure universelle, à assurer qu’effectivement, sur toutes les horloges précises de la terre, l’aiguille des minutes et celle des secondes indiqueraient, au même instant, le même chiffre.
La première idée qu’on avait eue était d’unifier l’heure par télégraphe électrique. A cet effet, la pendule de l’Observatoire est munie d’un dispositif qui envoie dans des lignes télégraphiques des signaux très courts, à des heures convenues. Ces signaux sont reçus dans les stations intéressées ; suivant les cas, ils sont enregistrés graphiquement ou simplement perçus à l’oreille, et permettent aux observateurs de ces stations de connaître exactement la « marche » de leur pendule ou de leur chronomètre, c’est-à-dire l’écart qu’ils présentent avec la pendule type du premier méridien.
Ce procédé permet la précision du dixième de seconde, ce qui est déjà bien ; mais il a l’inconvénient d’exiger un « fil », et, par conséquent, de ne pouvoir s’appliquer ni à l’envoi de l’heure aux navires en mer, ni à cet envoi aux explorateurs qui parcourent des contrées inconnues. De plus, en ce qui concerne la distribution de l’heure, celle-ci ne pouvait être faite qu’à quelques centres importants, qui devaient, à leur tour, la transmettre à des stations secondaires. De là des complications et des introductions de cause d’erreurs inévitables.
(3) – Par une loi du 9 mars 1911, la France renonce à imposer le méridien de Paris comme référence temporelle et point de départ des fuseaux horaires. Elle se rallie comme le reste du monde au méridien de Greenwich, ville proche de Londres, où se situe l’observatoire royal anglais. Ce méridien passe à proximité du Havre, de Caen et du Mans. Dans la nuit du 18 au 19 mars 1911, toutes les horloges de France s’arrêtent à minuit pour repartir 9 minutes et 21 secondes plus tard afin de se mettre en concordance avec le temps universel (Greenwich Mean Time, en abrégé « GMT » ou « temps moyen à Greenwich »). C’en est bel et bien fini de la rivalité franco-anglaise, en astronomie comme en politique.
A suivre …