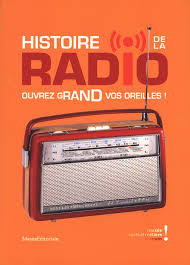A la fin du 19ème siècle, la T.S.F. (télégraphie sans fil) a pris son essor et voit ses domaines d’application se multiplier ; la diffusion de signaux horaires bénéficie de ces progrès pour s’effectuer sur des distances de plus en plus grandes. Les lignes qui suivent ont essentiellement été tirées d’un très vieil ouvrage du début de la TSF, il faut donc se replacer et s’imaginer être en 1914.
Par Jean-Luc Desgrez – F5NKK
Suite de la partie 6 et fin de l’article
C’est l’ingénieur français Edouard Belin(5) (figure 6) qui a résolu le problème de la façon la plus élégante et la plus précise, par son appareil émetteur de signaux horaires, qui fonctionne à l’Observatoire de Paris depuis le 31 juillet 1913.

Figure 6 – Edouard Belin
Cet appareil (figure 7) met en jeu une énergie locale : celle d’un poids moteur, qui est simplement déclenché par la pendule, à l’aide d’un contact électrique, au moment voulu. La chute de ce poids met en marche, avec une vitesse rigoureusement uniforme, maintenue constante par un régulateur centrifuge de haute précision, un cylindre sur lequel sont des disques « distributeurs de signaux ». Ces disques portent, sur leur circonférence, des dents espacées suivant les intervalles qui séparent les points et les traits des signaux horaires, et un contact, au moment où ces dents passent devant lui, actionne un relais et émet directement les signaux horaires par l’intermédiaire des ondes électriques de la Tour Eiffel avec laquelle l’appareil est relié par une ligne télégraphique directe.
Ce qu’il y a de remarquable dans cet appareil, c’est qu’il n’est ni un pendule, ni un garde-temps. C’est un engin automatique qui se met en mouvement par la commande précise d’une pendule directrice ou intermédiaire synchronisée, munie de dispositifs convenables de déclenchement. Il ne nécessite normalement aucune mise à l’heure spéciale, et son fonctionnement est exact si la pendule directrice est, elle-même, rigoureusement mise à l’heure.
Le système, purement mécanique, est synchronisé toutes les dix secondes par un pendule produisant une rupture de circuit toutes les deux secondes : le moment de la fonction de synchronisme a été choisi entre les signaux, et l’arrêt qui se produit à cet instant n’est perceptible que pendant les appels. On peut ainsi s’assurer de la régularité de marche de l’appareil avant l’émission des signaux horaires proprement dits. Du reste, bien que le régime de marche des cylindres distributeurs de signaux ne soit pas modifié, il a cependant été tenu compte du temps d’arrêt de synchronisme lors de la construction, et la précision exacte est rigoureusement entretenue.

Figure 7a – Appareil émetteur de signaux horaires (ensemble)

Figure 7b – Appareil émetteur de signaux horaires (partie supérieure)
L’émission est produite par l’ouverture brusque d’un interrupteur de haute précision, dont le fonctionnement ne nécessite qu’un effort négligeable, incapable d’apporter à la marche de l’appareil la plus petite perturbation. Quand cette émission est terminée, le poids moteur est automatiquement remonté par un moteur électrique dont la mise en route est réglée par un contact de « fin de course », et l’appareil revient de lui-même à sa position d’origine ; A ce moment, tous les circuits sont automatiquement coupés, et l’appareil, remis à l’heure pour l’envoi suivant, ne consomme, entre temps, absolument rien. Ramené à l’insensibilité complète, il ne risque, entre deux séries d’émission, ni dérangement ni déréglage.
La mise à l’heure peut être assurée avec une précision toute particulière de l’ordre du millième de seconde. Elle peut être effectuée soit à l’arrêt, soit pendant la marche, par la manœuvre d’un bouton extérieur, et la lecture se fait sur un tambour micrométrique. La durée des signaux peut, s’il est nécessaire, être modifiée par un bouton à division micrométrique.
Le fonctionnement de l’appareil est assuré par deux petites batteries d’accumulateurs, qui, pour une capacité de 20 ampères-heure, doivent être chargées seulement deux ou trois fois par mois. La première, de 8 volts, est destinée aux relais ; la seconde, de 12 volts, est destinée à l’électro-aimant de synchronisme ainsi qu’au moteur qui sert à remonter le poids.
Enfin, ajoutons que, indépendamment des signaux d’appel et des signaux horaires prévus par la Conférence, l’appareil peut envoyer, pendant la minute précédente, des signaux préalables facultatifs ayant chacun la durée d’une seconde ronde. Ces signaux, destinés au contrôle des relais et aux réglages qui pourraient sembler nécessaires, ne sont émis que si l’on presse sur un bouton extérieur à l’appareil, et tant que l’on presse sur ce bouton ; il est ainsi impossible de commettre le moindre oubli, et ces signaux spéciaux ne risquent, en aucun cas, d’être émis involontairement.
Tel est, dans ses grandes lignes, l’appareil émetteur de signaux de l’ingénieur Edouard Belin. Il a été placé à l’Observatoire de Paris, le 28 juillet 1913 ; une vérification de son fonctionnement fut faite le lendemain, 29 juillet, et, en raison de la précision du résultat, l’appareil fut mis en service effectif le 31 juillet ; Depuis ce jour, l’appareil a assuré le service de l’heure sans nécessiter la moindre retouche.
TECHNIQUE DE LA TRANSMISSION DES SIGNAUX HORAIRES : Enfin, disons un mot des conditions techniques dans lesquelles ces signaux sont envoyés : car il ne suffisait pas d’unifier le mode de leur envoi, mais il fallait réglementer du même coup les caractéristiques de leur émission au point de vue radiotélégraphique.
Il fallait, d’une part, faciliter à tous la réception de l’heure en permettant l’installation de récepteurs aussi simples que possible et d’un prix de revient aussi réduit que possible. Il était nécessaire, d’autre part, afin d’éviter la perturbation provenant d’ondes similaires, de décider l’adoption d’une ou plusieurs longueurs d’onde déterminées pour transmettre les signaux horaires. La Conférence de l’heure s’est rangée à l’avis le plus simple : celui de l’adoption d’une longueur d’onde unique de 2 500 mètres.
Certes il eût pu paraître désirable d’employer, pour les signaux horaires, une longueur d’onde plus courte, dans le but de faciliter leur réception par les navires qui fonctionnent habituellement avec la longueur d’onde de 600 mètres ; mais il faut bien remarquer que le matériel radiotélégraphique s’est grandement perfectionné pendant les dernières années : on ne peut plus considérer l’emploi d’ondes de grande longueur comme une complication, et l’on peut toujours organiser à bord des dispositifs nécessaires à leur réception. D’autre part, ces ondes de grande longueur ont bien des avantages : elles se propagent plus loin et mieux, surtout dans les pays tropicaux, où, au cours de la journée, les ondes courtes sont vite atténuées.
Enfin, grâce à l’étude que nécessite la transmission précise des signaux horaires à grande distance, des expériences décisives vont être instituées pour élucider diverses parties encore obscures en matière de T.S.F., en particulier sur le rôle, encore mal connu, de l’antenne : les expériences réalisées en Allemagne, où l’on a pu recevoir les ondes de Glace-Bay, au Canada, simplement avec des fils nus couchés par terre, montrent qu’il y a encore beaucoup à apprendre dans cette voie.
Ce sera la Conférence de l’heure qui aura eu le mérite de tracer la route à suivre.
Quoi qu’il en soit, les avantages de la transmission radiotélégraphique de l’heure commencent à susciter un intérêt certain; on commence à s’en préoccuper dans divers pays, et notamment chez nos voisins belges : à la date du 21 février dernier, le ministre des postes et télégraphes vient de décider l’organisation régulière de la transmission de l’heure effective deux fois par jour par la station de la Tour Eiffel. A cet effet, trente-quatre bureaux de télégraphe vont être munis d’antennes et de postes de réception des signaux ; Ces bureaux pourront ainsi recevoir les signaux horaires leur fournissant l’heure exacte et transmettre cette heure, télégraphiquement cette fois, aux bureaux secondaires.
(5) – Edouard Belin : Né le 5 mars 1876 à Vesoul (Haute-Saône) et mort le 4 mars 1963 à Territet (Canton de Vaud, Suisse), est un ingénieur français, inventeur du bélinographe, système de transmission à distance des photographies en usage dans la presse des années 1930 à son remplacement par la transmission de fichiers numériques cinquante ans plus tard. La société Édouard Belin, installée à Rueil-Malmaison, a produit des appareillages techniques et de laboratoire. En 1925, la société Édouard Belin dépose la marque Télétype.
Fin de l’article
Bien sincèrement – Jean-Luc Desgrez – F5NKK