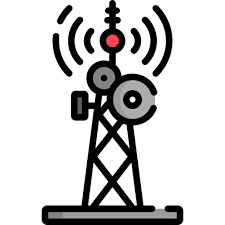DEUXIÈME PARTIE
DEUXIÈME PARTIE
L’art des signaux au moyen âge.
Polybe avait créé, chez les Grecs, l’art des signaux par l’invention du système alphabétique. Mais, comme nous l’avons fait remarquer, la multitude des mouvements nécessaires pour indiquer une phrase, aurait produit une confusion et une perte de temps considérables, et rendu ainsi impossible la transmission d’une dépêche un peu étendue.
Le système alphabétique de Polybe, comme aussi le système phrasique des Romains et des Orientaux, ne pouvaient servir que dans les camps, pour communiquer d’un quartier à un autre, pour donner des ordres ou faire passer des avis à une ville assiégée. Une correspondance générale de télégraphie ne pouvait s’accommoder de moyens aussi imparfaits.
Pour écrire de loin, selon l’objet et l’étymologie du télégraphe, il faut voir de loin. Avant la création de la physique, et en particulier de l’optique, on ne pouvait donc arriver à aucun résultat sérieux en ce genre.
L’invention des miroirs concaves réflecteurs, mais surtout l’invention de la lunette d’approche, pouvaient seuls permettre de créer l’art télégraphique. Aussi faut-il arriver jusqu’au 16ème et au 17ème siècle, pour assister à la naissance, ou du moins aux premiers essais, d’une télégraphie sérieuse.
Déjà, au 15ème siècle, l’illustre et malheureux Roger Bacon avait parlé de la possibilité de se servir de grands miroirs concaves pour voir à longue distance. Roger Bacon croyait que Jules César, quand il se préparait à traverser la mer, pour attaquer la Grande-Bretagne, s’était servi de ce moyen pour voir ce qui se passait de l’autre côté du détroit. Il en concluait que l’on pourrait par le même système, c’est-à-dire avec de grands miroirs concaves, apercevoir de loin les villes et les armées.
Jean-Baptiste Porta, l’inventeur de la chambre obscure, l’auteur de la Magie naturelle, était si bien persuadé de la possibilité de réfléchir de très-loin les rayons lumineux, au moyen des miroirs concaves, qu’il parlait d’établir un télégraphe, en faisant réfléchir sur la surface de la lune, qui aurait servi de plan réflecteur, des signaux formés sur la terre.
Déjà, un rêveur du moyen âge, Corneille Agrippa, qui avait l’exagération scientifique de Porta, sans avoir le génie d’observation et de recherches de celui-ci, avait prétendu que Pythagore, voyageant en Égypte, écrivait à ses amis au moyen de caractères expédiés sur la lune.
Le père Kircher, bien qu’il fût tout aussi infatué de merveilleux que les hommes de son temps, taxe de chimérique l’idée de Jean-Baptiste Porta. Pour que la lune, nous dit Kircher, pût produire cet effet, il faudrait qu’elle eût la propriété de réfléchir les objets comme une glace ; que le miroir qui lui ferait passer les signaux fût aussi grand que le diamètre de la terre, et que chaque signal eût vingt degrés de hauteur.
Si l’invention de Porta est quelque peu difficile à comprendre, l’objection de son savant critique est encore plus obscure pour nous. Mais c’est ainsi que l’on discutait entre savants, au moyen âge.
Le père Kircher, qui blâmait, chez Porta, l’usage de la lune comme moyen de télégraphie, s’accommodait pourtant du soleil dans la même intention. Il aurait voulu se servir, comme nous allons le dire, des rayons solaires, pour correspondre entre des lieux éloignés.
Chappe, dans son Histoire de la télégraphie, décrit ainsi le procédé de Kircher :
« Son procédé était d’écrire sur un miroir de métal les lettres des mots qu’il voulait transmettre : on plaçait à quelque distance une lentille de verre, au travers de laquelle on réfléchissait avec le miroir les rayons du soleil sur le lieu où l’on voulait les faire parvenir.
Ce lieu doit être une chambre dont les murs intérieurs soient peints en noir. L’image des caractères tracés sur le miroir se dessine sur la muraille ; les lettres conservent même la couleur qu’on leur a donnée en les écrivant ; et si, au lieu d’une phrase, vous peignez une figure, le spectre réfléchi par le miroir conserve les formes et les couleurs que vous avez données au dessin. C’est ainsi que Roger Bacon, dit Kircher, se rendait visible à ses amis absents.
« La même méthode peut servir pendant la nuit : en recueillant les rayons d’un flambeau ou de la lune avec un verre propre à grossir les objets, les caractères et les dessins, dit Kircher, seront portés fort loin.
« Cette dernière phrase nous paraît fort vague ; c’est la distance à laquelle les rayons peuvent être réfléchis, qui est le point capital dans cette opération ; il paraît incroyable, remarque Kircher lui-même, qu’avec un miroir on puisse se parler à une distance de trois lieues ; car les caractères tracés sur la glace s’affaiblissent à raison de l’éloignement, et se grossissent jusqu’à devenir comme des tours. Ma découverte n’en est pas moins certaine ; c’est une chose indubitable, c’est une chose vraiment divine ; je ne l’ai confiée qu’à une seule personne, et elle peut assurer la réalité de ce que j’avance.
« Il est difficile de bien juger de cette espèce de lanterne magique, sans faire une suite d’expériences qui puissent servir à constater les faits annoncés par l’auteur, et à trouver ceux dont il avoue n’avoir eu ni le talent ni les moyens de faire la découverte. »
Un autre savant de cette époque, François Kessler, ne portait pas ses prétentions aussi loin que le père Kircher, ou son prédécesseur Jean-Baptiste Porta. Il n’avait recours ni au soleil ni à la lune, et s’il employait une lumière, nous allons voir qu’il la mettait littéralement sous le boisseau.
En effet, Kessler enfermait à l’intérieur d’un tonneau, une lampe munie d’un réflecteur. Au-devant du tonneau était une trappe qu’on levait ou abaissait au moyen d’une tige recourbée à angle droit, de façon à apercevoir ou à cacher à volonté, la lampe placée dans le tonneau. La trappe élevée une fois, indiquait la première lettre de l’alphabet ; abaissée deux fois, elle indiquait la seconde, et ainsi de suite.
C’était toujours, on le voit, le système alphabétique de Polybe ; seulement, il était mis en pratique par des moyens bizarres.
On peut appliquer la même remarque critique aux projets de Gaspard Schott et de Becher, médecins de l’électeur de Mayence. Ils proposèrent de se servir de bottes de paille ou de foin, qu’on ferait rouler sur cinq mâts séparés les uns des autres.
Chaque mât devait être partagé en cinq divisions, chaque division ayant la valeur d’une lettre, qui aurait été ainsi désignée par la hauteur qu’occupait sur le mât la botte de foin. Un flambeau aurait remplacé, pendant la nuit, la botte de foin.
C’était une amélioration au système de Polybe, en ce que cette méthode n’exigeait que deux signes par lettre ; mais ces divisions n’eussent pas été facilement aperçues. Becher le sentit lui-même, comme on le voit dans une lettre qu’il écrivit à Schott, où il annonçait qu’il n’emploierait plus que deux signaux.
Becher n’a pas expliqué de quelle manière il eût combiné ces deux signaux ; mais ce ne pouvait être que par l’arithmétique binaire qu’il avait, à ce qu’il paraît, découverte avant Leibnitz.
Le système de Becher, malgré l’emploi de l’arithmétique binaire, n’aurait donné aucun bon résultat. Il aurait exigé autant de signaux que la répétition des feux de Polybe. D’après Chappe, il aurait fallu onze signaux pour exprimer un nombre de cinq chiffres.
Toutes ces tentatives ne pouvaient aboutir à aucun résultat utile, parce qu’elles ne reposaient point sur des expériences exactes.
Il en fut tout autrement de celles d’un physicien anglais, Robert Hooke, qui, à la fin du 17ème siècle, exécuta et mit en pratique un télégraphe à signaux, qui peut être considéré comme le premier modèle du télégraphe aérien moderne.
Robert Hooke substitua aux drapeaux et aux pavillons, dont on avait fait souvent usage, des corps opaques de forme particulière, placés très-haut en l’air, et visibles à de grandes distances. Dans un Discours lu le 21 mars 1684, à la Société royale de Londres, Robert Hooke décrit avec beaucoup de soin l’appareil qu’il a inventé. Il insiste sur la manière de placer les stations à des distances convenables, sur le meilleur éclairage des machines, etc. Toutes ces observations dénotent un physicien habile.
La machine que Robert Hooke avait construite, consistait en un large écran, c’est-à-dire une planche peinte en noir, placée au milieu d’un châssis, et élevée à une grande distance en l’air. Divers signaux, de forme particulière, étaient cachés derrière l’écran, et servaient, quand on les faisait apparaître, à exprimer les lettres de l’alphabet. Quelques signaux n’exprimaient pas des lettres, mais des phrases convenues d’avance.
Télégraphe de Robert Hooke.
Cette figure représente le télégraphe de Robert Hooke. A était la planche peinte en noir derrière laquelle étaient cachés les signaux, B, C, que l’on faisait apparaître à volonté en tirant la corde D.
Robert Hooke entendait se servir de ce télégraphe même pendant la nuit. Mais on ne connaît pas exactement les dispositions qui lui étaient venues à l’esprit pour cette télégraphie nocturne, parce que cette partie de son mémoire manuscrit n’a pas été retrouvée intacte.
Le Discours lu par Hooke à la Société royale de Londres, a été publié dans les œuvres posthumes de ce savant. Or, l’éditeur fait remarquer que le manuscrit de l’auteur avait des feuilles déchirées et des pages d’une écriture illisible, dans la partie qui concerne son télégraphe nocturne ; de là l’obscurité qui règne dans la description qu’il en a donnée.
d’après Wikipédia Wiki Source et autres, compilation F5LBD