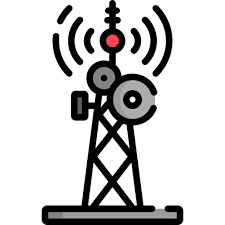SEPTIÈME PARTIE
- Comment fut établie sur le territoire de la république française la première ligne de télégraphie.
- Création de la ligne de Paris à Lille.
Le Comité de salut public fut chargé par la Convention nationale, de diriger l’établissement des postes télégraphiques. Le 4 août 1793, ce Comité suprême décida, sous l’inspiration de Carnot, que deux lignes seraient créées d’urgence : la première partant de Lille, pour aboutir à Paris ; la seconde de Paris à Landau, ville de Bavière, alors au pouvoir de la France, et qui marquait la limite présente de ses frontières à l’Est.
L’idée qui présida à l’adoption de la télégraphie au sein de la Convention, et qui détermina le choix des deux lignes que nous venons d’indiquer, était donc toute militaire. On va comprendre ce qui décida à établir de préférence ces deux voies télégraphiques, aboutissant l’une à Lille, l’autre à Landau.
On était au plus fort de l’invasion étrangère, et nos armées, refoulées au nord par les Autrichiens, étaient en pleine retraite. Condé et Valenciennes étaient au pouvoir de l’ennemi. Le prince de Cobourg marchait sur Paris, à la tête de 180 000 hommes. Il était suivi d’un corps de 20 000 Autrichiens et Hanovriens, sous les ordres du duc d’York. Luxembourg et Namur étaient occupés par le prince de Hohenlohe, avec 30 000 Allemands. Enfin 76 000 hommes, commandés par le roi de Prusse et le général Würmser, étaient échelonnés entre les Vosges et Lauterbourg.
40 000 Piémontais, appuyés par 8 000 Autrichiens, avaient franchi les Alpes, et menaçaient le Midi ; et tandis que les défilés des Pyrénées étaient occupés par 22 000 Espagnols, Toulon était aux mains des Anglais.
D’un autre côté, Lyon, qui s’était insurgé contre la Convention, arborait ouvertement le drapeau de la révolte, après avoir chassé les représentants du peuple. La Vendée avait, de son côté, pris les armes contre la République.
Pour faire face à tant d’ennemis au dehors, à tant de révoltes au dedans, la Convention disposait de 400 000 hommes, à peine. Ces hommes étaient mal vêtus, mal nourris, mal disciplinés, mal payés.
Il est évident qu’une découverte comme celle du télégraphe de Chappe, qui devait permettre aux chefs d’armée de correspondre rapidement entre eux, et qui donnait aux villes assiégées, la faculté de faire passer des signaux et des dépêches par-dessus le front des corps assiégeants, était un sourire que la Providence adressait à la France au milieu de ses angoisses.
C’est ce que comprit le Comité de salut public. C’est pour cela qu’il décida que des télégraphes seraient placés aux abords des villes assiégées, et que les lignes à établir partiraient de l’extrémité des frontières, c’est-à-dire de Lille et de Landau, pour aboutir à Paris. Il plaça les télégraphes sous la direction du ministre de la guerre ; mais il s’en réserva la direction supérieure, et le ministre ne dut se servir des télégraphes que d’après ses ordres.
Les frères Chappe furent mis à la tête de l’administration des télégraphes. Mais comme ils ne pouvaient suffire, à eux seuls, à l’organisation d’un service si nouveau, on leur adjoignit d’abord, en qualité de commissaire du gouvernement, le citoyen Garnier, qui ne conserva que peu de temps ces fonctions ; ensuite le citoyen Delaunay (l’inventeur du vocabulaire) et les citoyens Brunet et Barcon, amis des frères Chappe.
La République n’était pas seulement menacée par toute sorte de périls, extérieurs et intérieurs. Elle était fort pauvre. Aussi le Comité de salut public recommanda-t-il la plus sévère économie dans l’autorisation des dépenses nécessaires pour la construction des machines et des postes télégraphiques. Dans son rapport à la Convention, Lakanal avait proposé de construire les appareils et d’aménager les stations avec des objets faisant partie du mobilier de l’État. Cette idée fut mise en pratique. Les lunettes d’approche, comme les lits, les chaises, les tables, et tout le matériel qui pouvait s’adapter à cette destination nouvelle, furent tirés des magasins de l’État. On poussa l’économie jusqu’à décider que les télégraphes qui avaient servi aux expériences exécutées par Chappe, devant les commissaires de la Convention, seraient enlevés et transportés sur la ligne en construction.
D’après les devis présentés par Chappe, qui étaient basés sur les plus stricts besoins, le Comité de salut public mit à la disposition du ministre de la guerre, la somme de 166 240 francs, pour construire la ligne de Lille à Paris. Il faut remarquer, pour réduire ce chiffre à sa véritable signification, que cette somme de 166 240 francs était en assignats, et que déjà les assignats avaient perdu 40 p. 100 de leur valeur nominale. Avec cette réduction, la somme qui était mise à la disposition de l’ingénieur-télégraphe, pour conserver le nom officiel que portait Claude Chappe, ne représentait guère que 80 à 90 000 francs.
C’était assurément un grand point que d’avoir arrêté en principe l’établissement de la télégraphie sur le territoire de la République, et d’avoir pris les meilleures mesures administratives applicables à cet objet. Mais ce n’était pas tout. Il ne suffisait pas de décréter, il fallait exécuter, et c’était là le point difficile. Avec la France en feu, la pénurie de l’État, l’absence des matériaux de toutes sortes, et les défiances universelles des populations, improviser seize stations télégraphiques, au milieu des campagnes agitées, fabriquer le matériel des instruments et le mettre en place, c’était un ensemble d’opérations qui aurait été impossible chez une autre nation que la France de 1793. Mais le zèle patriotique faisait naître tant de dévouements particuliers, excitait le génie de tant d’individus, que ce miracle vint s’ajouter à tous ceux qui honorèrent alors et sauvèrent notre patrie.
Il y avait deux objets à remplir : établir en pleine campagne, les maisonnettes des stationnaires ; construire, à Paris, les appareils télégraphiques.
Claude Chappe se réserva la construction mécanique, et chargea ses collègues de la seconde partie du programme, c’est-à-dire de l’exécution de la ligne.
C’est dans la construction des lignes en pleine campagne que se rencontrèrent les plus grands obstacles. Ici tout était nouveau ; il fallait tout créer. Le tracé de la ligne, la distance des postes, le choix des emplacements de chaque station, étaient autant d’études qu’il fallait entreprendre sans aucune espèce de précédent. Les agents de Chappe firent toutes les opérations sur le terrain, en se servant eux-mêmes du niveau et des instruments d’arpentage. Avec quelques principes d’optique, et quelques données sur la météorologie locale, ils se mirent à l’œuvre pour la première opération à entreprendre, c’est-à-dire le tracé de la ligne et la désignation de l’emplacement des stations.
Le gouvernement, pour faciliter leurs travaux, donna l’autorisation de placer les télégraphes sur les tours, clochers et édifices appartenant à l’État ou aux communes. Il permit de faire abattre ou élaguer les portions de bois ou d’arbres qui arrêtaient les rayons visuels d’une station à l’autre, et d’établir des constructions sur les terrains, quels que fussent leurs propriétaires. Des experts, nommés par la municipalité et par les propriétaires, fixaient les indemnités accordées soit pour les arbres abattus, soit pour le loyer des terrains occupés par les constructions.
Après ces opérations préliminaires, les agents de Chappe se distribuèrent le long de la ligne adoptée, pour faire commencer la construction des maisonnettes destinées à recevoir l’appareil, soit dans les villes, soit dans la campagne.
Mais c’est ici que les difficultés commençaient. L’industrie ne pouvait fournir aucun instrument de précision, aucun outil autre que celui qui servait aux travaux les plus grossiers. On ne fabriquait alors que des armes, et l’industrie française n’était propre à aucune autre production. On n’avait ni bois sec, ni métaux, ni matériaux de bâtisse. Dès les premiers jours, on s’aperçut qu’il n’y avait ni pierres pour les maçons, ni bois pour les charpentiers. Il fallait aller chercher le bois dans les forêts, et la pierre dans les carrières. Quand on avait équarri les poutres et taillé les pierres, on ne trouvait aucun moyen de transport. Les chevaux étaient tous pris pour le service de l’armée, et les paysans ne consentaient pas à se séparer de leurs bêtes de trait. Le Comité de salut public, qui avait mis en réquisition tous les matériaux disponibles sur le parcours de la ligne, dut aussi mettre en réquisition des hommes, et les chevaux des propriétaires et des paysans. Ce n’était pourtant qu’à force de prières ou de menaces qu’on parvenait à obtenir quelques bêtes de trait.
Puis, lorsqu’à grand’peine, le bois, la pierre, les métaux étaient enfin rendus aux points désignés pour l’emplacement des maisonnettes télégraphiques, on ne trouvait point d’ouvriers. Le maçon, le charpentier, le serrurier, étaient partis, parce qu’ils n’étaient pas payés ou parce qu’on les payait en assignats, le désespoir des campagnes. Les inspecteurs étaient alors forcés de prendre eux-mêmes la truelle en main, de manier le rabot ou le marteau, pour transformer les paysans de la localité en maçons, en charpentiers, en serruriers. Mais le plus souvent, ces ouvriers improvisés profitaient de la nuit pour s’échapper du chantier.

Quant au payement des hommes, il se faisait sans aucune règle administrative. Les agents se remettaient les uns aux autres, et de la main à la main, les fonds que Claude Chappe leur envoyait, et cela sur parole, sans aucun reçu, sans le moindre système de comptabilité. Souvent ils étaient forcés de payer de leurs propres deniers les sommes qui n’arrivaient pas, afin de déterminer les ouvriers à reprendre des travaux suspendus depuis des semaines entières.
Ce n’est pas tout : il y avait encore à défendre les barraques télégraphiques et les instruments contre les défiances et la malveillance des habitants des campagnes. Le peuple de Paris avait, comme nous l’avons raconté, brisé les machines de Chappe, à deux reprises différentes. Les mêmes sentiments de méfiance régnaient dans les provinces, et souvent les ouvriers employés aux constructions des stations, comme les agents qui les dirigeaient, furent forcés de travailler le fusil en bandoulière ou le pistolet à la ceinture.
Les mêmes sentiments de suspicion se manifestaient jusque dans les villes. À Lille, par exemple, Abraham Chappe dut se produire dans les assemblées populaires et dans les clubs, pour expliquer que les travaux du télégraphe étaient entrepris dans le seul intérêt de la république, et pour la défense de son territoire.
C’est au prix de tant de peines, c’est grâce à tant de dévouements et d’efforts, que les seize stations de Lille à Paris furent construites dans l’intervalle de moins d’une année.
À mesure que les stations étaient terminées, Claude Chappe y apportait lui-même les appareils télégraphiques qu’il faisait fabriquer à Paris, dans un atelier de serrurerie placé sous sa direction.
Ce n’était pas sans peine qu’il était parvenu à établir dans la capitale cet atelier mécanique pour la construction de ses appareils. Bien qu’il ne s’agît, en définitive, que d’exécuter un même instrument d’après un modèle unique, l’inexpérience des ouvriers occasionnait de grands retards. Les matériaux mêmes faisaient souvent défaut. Il fallait pour construire en entier un télégraphe, environ 4 000 livres de fer, — 100 livres de fil de fer, — 128 livres de fil de laiton, — 118 de cuivre, — 1 350 de plomb laminé, — 510 livres de plomb brut, — 120 feuilles de fer-blanc, et 19 de tôle.
Tout cela n’était pas facile à se procurer. Puis, quand on avait rassemblé les matériaux, c’était souvent les ouvriers qui manquaient. Il fallait aller les chercher au club, et les ramener à l’atelier.
Claude Chappe habitait quai Voltaire, 23. Il correspondait avec les inspecteurs, qui lui adressaient un rapport tous les dix jours, sur l’état des travaux. Il faisait de fréquents voyages sur la ligne, et, comme nous l’avons dit, il allait lui-même établir sur place les appareils, au fur et à mesure de leur fabrication.
Au mois de mars 1794, la ligne était terminée, et pourvue, sur tout le parcours, de son matériel complet. Les stations étaient des maisonnettes de forme pyramidale, surmontées d’un échafaudage, sur lequel se dressait l’appareil à signaux.
Cet appareil, beaucoup plus lourd et plus massif que celui qui fut construit depuis, était presque tout de fer. La manipulation consistait à faire prendre aux bras 196 positions différentes. La moitié de ces signes, c’est-à-dire 98, étaient consacrés à donner des avis aux stationnaires pour le service ; l’autre moitié suffisait pour les signaux de la correspondance. Chacun de ces signaux servait à trouver un mot dans le vocabulaire, composé de 9 999 mots. Nous expliquerons plus loin l’emploi de ce vocabulaire.
Chaque poste était pourvu de deux lunettes d’approche. Deux stationnaires étaient affectés à chaque poste. Aux postes extrêmes seulement, c’est-à-dire à Lille et à Paris, il y avait quatre stationnaires. On avait pris ces agents parmi les anciens militaires, et les ouvriers capables d’apporter, sur place, aux appareils les réparations urgentes.
Quelques semaines furent consacrées à exercer tous les stationnaires de la ligne à l’exécution des signaux de la correspondance et du service.
Comme il importait que la tête de la ligne fût placée au milieu de la capitale, le Comité de salut public décida que le poste de Paris serait établi au-dessus du palais du Louvre. Cette station correspondait avec une autre placée sur la butte Montmartre. De son appartement du quai Voltaire, Claude Chappe, l’ingénieur-télégraphe, apercevait les signaux de l’appareil du Louvre, et pouvait en prendre note. Tout se passait sans faste et sans apprêt à cette époque où les services publics s’exécutaient par le concours simple et désintéressé de citoyens au cœur dévoué.
Ce fut à la fin de prairial 1794 que les Parisiens virent avec surprise se dresser, pour la première fois, sur le dôme du Louvre, le télégraphe de Claude Chappe, peint aux couleurs nationales.
(extrait de Wiki source)